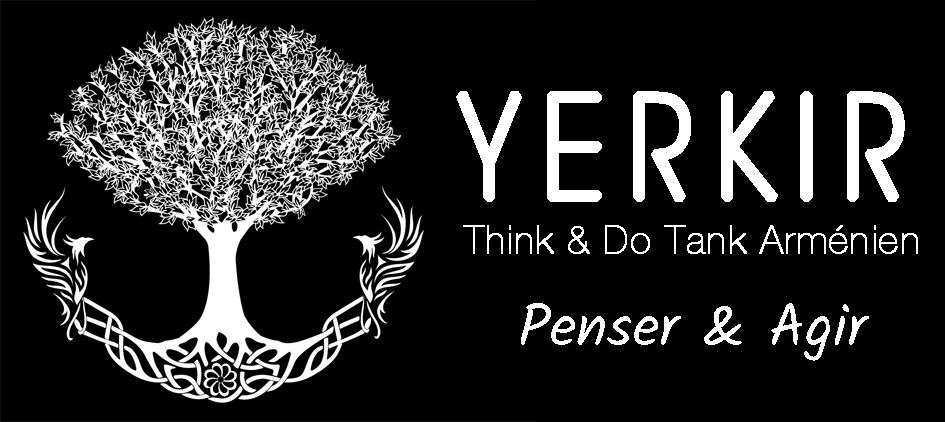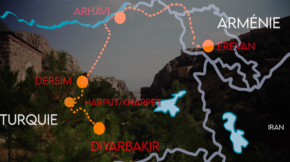Seyhan Bayraktar
Historienne turque, Université de Zurich (Suisse)
Dans cet article, Seyhan Bayraktar, qui a mené des recherches sur la rhétorique développée en Turquie autour du Génocide arménien, explique qu’une augmentation quantitative de discours n’indique pas nécessairement un changement paradigmatique vers une parole autocritique. Partant des années 70, elle décrit les diverses mutations du négationnisme de l’État turc à travers les décennies. D’un négationnisme de réaction, on passe progressivement à un autre, plus proactif. Selon l’auteure, on assiste à une institutionnalisation et à une professionnalisation du négationnisme. Aussi, les années 2000 se révèlent être une période de transition pendant laquelle la « question arménienne » s’inscrit progressivement dans le débat politique turc puis entre progressivement dans la communication politique quotidienne de la Turquie avec le 90ème anniversaire du Génocide. Une période délicate pour la Turquie, en pleines négociations d’entrée dans l’Union Européenne…
Les études existantes sur le négationnisme du Génocide arménien de 1915 se concentrent soit sur les politiques de l’État turc, soit sur l’ouverture grandissante de la société civile à des relectures de cet événement. À mon sens, ces deux approches réduisent le négationnisme à un ensemble de pratiques politiques et de mécanismes défensifs de la Turquie en privilégiant le rôle de l’État comme agent négationniste du génocide. Or si l’État est en effet un acteur dominant du négationnisme, en rester à cette bivalence État/société amène à négliger la puissance intrinsèque du discours et son omniprésence à travers divers champs sociaux et politiques, parfois même rivaux. Des travaux récents montrent combien il est de courte vue d’attribuer la négation du génocide uniquement à l’État turc. Le fait que des descendants d’anciens meurtriers conservent de vifs souvenirs d’Arméniens tués par leurs ancêtres a conduit certains à affirmer que le « gouvernement turc nie un génocide dont sa propre population [au contraire] se souvient ». Une telle équation entre la mémoire sociale et la reconnaissance du génocide est cependant problématique, tout comme la tendance de travaux récents à considérer l’explosion mémorielle autour du Génocide arménien comme un indicateur de l’émergence d’un véritable discours critique. Ainsi le débat autour de la négation du Génocide arménien a-t-il tendance à sous-estimer la contestation du concept même de génocide dans le discours politique turc et à dévaloriser l’importance de la lutte politique de près d’un siècle des victimes pour la reconnaissance du Génocide.
Mes recherches sur la rhétorique développée en Turquie autour du Génocide arménien pendant les « moments critiques du discours », entre 1973 et 2005, ont mis en évidence qu’une augmentation quantitative de discours n’indique pas nécessairement un changement paradigmatique vers une parole autocritique où les besoins des victimes auraient priorité sur l’identité nationale. Au contraire, la négation produite par l’État et ses instances dans les années 1970-80n’a cessé de gagner en sophistication. Pendant que l’État adoptait de nouvelles stratégies pour contrer les reconnaissances internationales du Génocide (en proposant par exemple une commission historique turco-arménienne, en annonçant la restauration de lieux culturels arméniens ou en développant la « diplomatie du football »), des schémas discursifs étaient élaborés – en particulier la notion de « terrorisme arménien » –qui se sont avérés particulièrement envahissants. En effet, non seulement ils ont résisté au temps mais ils se sont répandus à travers un éventail toujours plus large d’acteurs politiques et sociaux. En présentant un récapitulatif des différents stades de négationnisme et des structures et motifs clés de la mémoire publique et politique qui ont dominé le débat sur la question génocidaire, je montrerai que la négation du Génocide arménien a pris une forme très élaborée qui délimite et encadre les interactions turco-arméniennes. Et surtout, je réinscrirai ce discours dans le contexte matériel des relations extérieures de la Turquie, particulièrement avec l’Union européenne (UE) au début des années 2000, au plus haut de la pression mise sur la Turquie pour qu’elle examine son passé.
Avant de ce faire, cependant, je souhaite clarifier quelques principes fondamentaux de ma démarche. En étudiant la négation du génocide, j’adopte une position poststructuraliste selon laquelle les discours – en l’occurrence les schémas mémoriels sur le Génocide arménien dans la société et la politique turques – ne sont pas des épiphénomènes du politique mais sont des clés de la production et de la reproduction des structures de pouvoir. L’accès au discours et le contrôle et la sélection des schémas discursifs sont à la fois issus et sources de relations de pouvoir. Toutefois, à l’instar d’Ole Wæver, j’adopte une interprétation plus souple de la relation entre discours et locuteurs que celle définie par l’analyse poststructuraliste. Alors que cette dernière considère que les discours priment sur les locuteurs dans le sens où les sujets parlants n’existent pas hors du langage, cette étude-ci conceptualise les structures discursives telles qu’elles sont produites, reproduites ou transformées à travers une pratique entre locuteurs. Appliqué à l’étude de la négation du Génocide arménien, cela signifie que les schémas discursifs sur le Génocide arménien (quelle que soit leur origine) ainsi quela politique du passé de la Turquie (a) déterminent l’éventail des possibles dans la conception de la destruction des Arméniens et (b) qu’ils sont en même temps eux-mêmes dépendant des locuteurs qui les produisent. C’est cette sorte de « structuration linguistique » qui permet aux discours d’évoluer.
Avant le nouveau millénaire – mais surtout dans les années 1970 et 80 – le souvenir du génocide de 1915 n’émerge quasiment qu’en réaction à des sommations extérieures, sous la forme de pressions politiques. La politique mémorielle des Arméniens de la Diaspora (que ce soit à travers les attaques militantes contre les représentants de l’État turc ou la mobilisation politique pour la reconnaissance du génocide, surtout aux États-Unis) et les débats internationaux autour de la reconnaissance du Génocide suscitent non seulement une prise de conscience du Génocide à travers le monde mais rendent impossible pour la Turquie d’éluder la question. En conséquence, cette phase du négationnisme turc est marquée par son caractère réactif plutôt que proactif : d’une part, le « terrorisme arménien » devient alors l’explication unique et systématique des attaques arméniennes contre les officiels turcs ; d’autre part, apparaissent des tentatives claires de distinguer les Arméniens de Turquie – « nos Arméniens » – des Arméniens « vindicatifs » de la Diaspora. Le besoin évident dans la presse écrite turque des années 1970 de différencier explicitement les Arméniens intérieurs (« nos Arméniens ») des « Arméniens de la diaspora » est alors accompagné d’appels au calme et à ne pas répéter les violences des 6 et 7 septembre 1955, lorsque des émeutes orchestrées par l’État à Istanbul avaient visé respectivement les populations grecques et non-musulmanes. Dans cette première phase du discours, les échanges politiques entre Turcs et Arméniens dans l’espace public turc étaient inexistants. Du fait de sa position hautement vulnérable, la communauté arménienne de Turquie restait invisible et ne prenait pas part activement au discours sur son propre vécu historique et sa destruction. Au lieu de cela, le Patriarche se faisait le représentant de la communauté dans la sphère publique et, lorsque des diplomates turcs étaient tués par des Arméniens, présentait ses condoléances au nom de cette communauté. Ce schéma de relations turco-arméniennes en Turquie, où les Arméniens étaient invisibles dans l’arène publique, n’a commencé à se fissurer que vers l’an 2000.
Au cours des années 1980, le négationnisme s’institutionnalise et se professionnalise : une agence spéciale appelée Istihbaratve Arastirma Mürdürlügü (Directorat général du renseignement et de la recherche) est fondée au sein du Ministère des Affaires étrangères afin de coordonner toutes les questions relatives au Génocide arménien et de formuler la politique de l’État à l’égard du passé. Une des stratégies les plus efficaces de cette agence fut de formuler la « question arménienne » comme un problème de terrorisme contemporain plutôt qu’une conséquence du passé génocidaire de la Turquie et de l’absence de toute justice ou réparation. Cette stratégie de négation du génocide a fait florèsdans la mesure où le concept de « terrorisme arménien » a perduré au-delà des années 1970-80,où les assassinats avaient lieu. Ce concept a même gagné en légitimité avec le temps puisqu’il est à présent invoqué non seulement par les acteurs gouvernementaux et nationalistes mais aussi par des voix critiques appelant au dialogue turco-arménien. L’exemple suivant en est une illustration, qui montre non seulement l’usage non critique qui est fait de ce concept dans le contexte des relations turco-arméniennes mais aussi son apparente acceptabilité au-delà des seuls cercles de l’État et des nationalistes turcs : en 2008, quand des intellectuels turcs initièrent une « Campagne pour le Pardon »poussant le gouvernement à exprimer des regrets, des nationalistes organisèrent une contre-campagne exigeant des excuses des Arméniens eux-mêmes ! Une telle réaction, inversant les rôles bourreaux-victimes et brouillant les processus historiques de cause à effet,était néanmoins peu surprenante pour qui suivait la question très tendue du génocide en Turquie.Mais, plus étonnant, un des principaux organisateurs de la « Campagne pour le pardon », l’intellectuel renommé Baskın Oran, s’est aussi prononcé en faveur d’excuses publiques des Arméniens pour les crimes de l’Armée secrète arménienne de libération de l’Arménie (ASALA). Oran soutenait qu’une telle expression de contrition publique stimulerait la prise de conscience critique grandissante du Génocide arménien en Turquie et contribuerait à la réconciliation turco-arménienne. Ainsi mettait-il sur le même plan la nécessité pour la Turquie de se confronter au Génocide arménien, un événement fondateur de la Turquie moderne, avec la nécessité pour les Arméniens de prendre la mesure de la violence d’une organisation terroriste. Or l’équation de différentes manifestations de violence comporte le risque de vouloir les faire se justifier mutuellement. Dans le cas du Génocide arménien une telle équation n’est qu’un indicateur de plus du fait que même les acteurs les plus progressistes de la société turque emploient le concept inventé par l’État de « terrorisme arménien » sans prendre en compte le manque d’un regardhistorique critique de la Turquie sur son passé et les effets durables du processus génocidaire sur les Arméniens.
Les années 2000-2002 sont une période de transition pendant laquelle la « question arménienne » s’inscrit progressivement dans le débat politique turc. La principale différence entre ce stade de négation du génocide et le précédent est que la destruction des Arméniens – ainsi que celle d’autres groupes de l’Empire ottoman, comme les Assyriens – se trouve de plus en plus souvent abordée indépendamment de sollicitations extérieures spécifiques et concrètes. Au cours de cette phase, la Turquie commence aussi à réviser sa politique historique, constatant que son approche conventionnelle du problème, centrée sur la sécurité et le terrorisme, n’a pas réussi à freiner la reconnaissance internationale du génocide. La motion de reconnaissance du Génocide par la France, en 2001, conduit la Turquie à repenser sa politique vis-à-vis de la République d’Arménie. Après avoir systématiquement mis l’Arménie sous pression en l’isolant, Ankara tente un rapprochement prudent en encourageant des contacts discrets au niveau de la société civile et facilitant l’obtention de visas pour les citoyens de la République d’Arménie. La Turquie cherche ainsi à saper les efforts de la diaspora arménienne. Toutefois, ni la politique d’isolement ni la politique de rapprochement ne produisent les résultats escomptés par la Turquie : elles n’empêchent pas d’autres reconnaissances du Génocide ni les appels de la République d’Arménie à d’autres déclarations internationales.
Suit une phase où le Génocide arménien entre dans la communication politique quotidienne de la Turquie,avec le 90ème anniversaire du Génocide et l’année la plus délicate du processus d’accession de la Turquie à l’Union européenne, qui déciderait ou non d’initier les négociations d’entrée de la Turquie au sein de l’UE. Après que la Turquie s’est portée officiellement candidate à l’entrée dans l’UE, un intense débat agite les pays membres –surtout en France et en Allemagne – sur l’éligibilité européenne de la Turquie. Dans ce contexte, la relation problématique de la Turquie au Génocide devenait cruciale aux yeux d’opposants convaincus que le pays n’était pas assez européen. Au niveau institutionnel, le Parlement européen, chargé d’approuver la candidature d’un pays, réitéra sa résolution de 1987 sur le Génocide à plusieurs moments critiques des négociations – en 2000, 2002 et 2005 – exerçant ainsi une pression constante sur la Turquie. Ainsi, entre 1999 et 2005, la reconnaissance du Génocide arménien – ou au moins une réflexion critique sur le passé – devint-elle un critère informel d’entrée de la Turquie dans l’UE. Sur fond de débat nourri sur le Génocide arménien à travers les pays européens, le gouvernement turc fit des concessions tactiques afin de contrer la pression internationale. Quelques semaines avant le 90ème anniversaire du Génocide, son Premier ministre, Recep Erdoğan, prit contact avec le Président Kotcharian et proposa l’institution d’une Commission historique mixte arméno-turque. Le gouvernement annonça aussi la restauration de monuments arméniens culturels et religieux. Par exemple, la rénovation de l’église Sainte-Croix d’Aghtamar, sur le lac de Van, fut annoncée comme une avancée dans l’amélioration des relations arméno-turques et une tentative de freiner la multiplication des reconnaissances officielles du Génocide à travers le monde. Grâce à ces initiatives politiques, la Turquie obtenait deux résultats : elle signalait une ouverture sur le plan de sa lecture historique contestée de 1915 ; et simultanément, elle dépolitisait le problème en le déléguant à des « experts ». Cette nouvelle stratégie fut internationalement applaudie. La Commission indépendante sur la Turquie, par exemple, un groupe de politiques européens de haut vol, salua l’initiative de la Turquie tout en reprochant à l’Arménie de ne pas y répondre positivement. En 2005, une nouvelle annonce vint renforcer ces signes d’ouverture : trois des plus grandes universités turques annonçaient l’organisation d’un « Colloque arménien » se proposant de sortir du cadre imposé par le récit nationaliste turc sur le Génocide arménien. Mais en l’espace de quelques jours, les organisateurs – pourtant des figures établies du monde académique turc – se heurtèrent à une opposition et une pression politique majeures. Lors d’un discours parlementaire, le ministre de la justice Cemil Ciçek les accusa de « poignarder la nation dans le dos ». En conséquence, l’université invitante décida de repousser le colloque à plus tard.
La seconde tentative de mettre sur pied le colloque rencontra aussi des obstacles majeurs lorsqu’une cour de justice ordonna son arrêt. Cette fois-ci toutefois, le même ministre de la justice qui avait accusé le colloque de projet traître fournit lui-même le moyen de circonvenir la décision de justice : en changeant le lieu du colloque. En revanche, d’autres membres du gouvernement – tels que le Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan et le ministre des Affaires étrangères Abdullah Gül, exprimaient leur soutien à ce colloque. En coulisses, le gouvernement œuvrait pour qu’il se concrétise avant le sommet européen d’octobre 2005, lors duquel l’UE déciderait ou non d’engager les négociations d’accession avec la Turquie. Grâce à ce soutien du gouvernement, le colloque se tint finalement les 24 et 25 septembre 2005. La date choisie est déjà un indicateur concret qu’elle servait les intérêts de la Turquie dans sa candidature à l’UE. C’est d’ailleurs exactement ce que soulignaient les organisateurs du colloque dans leurs déclarations publiques : que le colloque servirait en fin de compte la Turquie et qu’il « serait un des pas les plus importants de notre pays (…) vers la démocratie ». Dans une déclaration commune, ils soulignaient que « démontrer (…) la riche pluralité de pensée du pays (…) serait extrêmement bénéfique à la Turquie. »Ainsi, non seulement les organisateurs et partisans du colloque rejetaient l’accusation d’être des traîtres et de nuire à la Turquie mais ils parvenaient à renverser le point de vue. De ce point de vue, le contre-discours des progressistes turcs reposait aussi sur une logique et une rhétorique fortement nationalistes. En fait, ces militants actifs pour le colloque n’exprimaient pas la nécessité intrinsèque d’examiner le passé, au-delà de tout bénéfice possible pour la Turquie. Ces limites de la controverse de 2005 autour du « Colloque arménien » d’une part et de la négation du Génocide arménien d’autre part, sont restées jusqu’à présent largement inexprimées. Au contraire, le colloque est généralement qualifié de pionnier dans les relations turco-arméniennes et en particulier dans le processus de confrontation de la Turquie à son Histoire.
Depuis lors, le dialogue turco-arménien s’est considérablement intensifié à toutes sortes de niveaux. Nous avons vu un rapprochement temporaire et tendu entre les deux États (à travers la diplomatie du football, les protocoles turco-arméniens, etc.) ainsi que de nombreuses rencontres entre Turcs et Arméniens de Turquie et de la diaspora. À l’occasion du centenaire du Génocide, en avril 2015, un nombre considérable d’Arméniens de la diaspora ainsi que d’intellectuels, de militants des droits de l’homme et d’organisations de la société civile turque choisirent de commémorer le Génocide en différents lieux de Turquie. Ces efforts mémoriels conjoints et la vague inédite de commémoration du Génocide en Turquie diffusèrent une onde symbolique particulièrement puissante, suggérant une nouvelle qualité des relations turco-arméniennes dans la société civile. Mais paradoxalement, bien que ces rencontres soient importantes, elles ne signifient pas nécessairement que les descendants des bourreaux aient entrepris un réexamen significatif du passé. La rhétorique turque est au contraire devenue, à l’époque du centenaire, plus extrême dans son négationnisme. La forme, le contenu et les messages des diverses commémorations ont néanmoins révélé combien il est difficile d’affronter la sophistication de la négation et d’ouvrir la voie vers la réconciliation qui soulève les questions cruciales de justice et de restitution.
Il reste donc à découvrir dans quelle mesure ces rencontres entre Turcs et Arméniens de la Diaspora sont fondées sur le même langage et une compréhension commune de la dynamique historique – et finalement contemporaine – des relations turco-arméniennes. Étant donné qu’on n’a jamais remis en question les effets prétendument pionniers du « Colloque arménien » de 2005 (et surtout pas parmi les universitaires organisateurs et leurs soutiens), il semble que les rencontres, dialogue et réconciliation turco-arméniens ne soient actuellement qu’une boîte noire. Une fois ouverte, cette boîte révélera sans doute que les vertus symboliques apaisantes de telles rencontres ont occulté le fait que la négation du Génocide s’est remarquablement adaptée à la mémoire, à la commémoration et aux co-résistances de la société civile arméno-turque face à une telle négation.