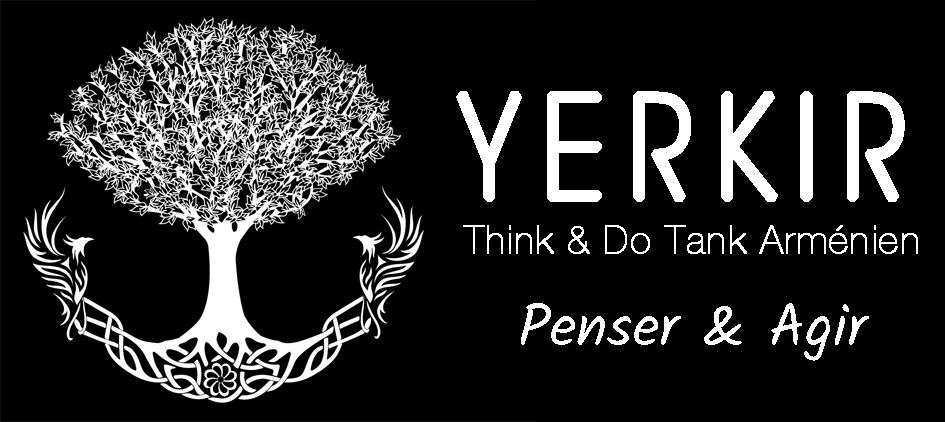Jean-François Pérouse
Directeur de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes d’Istanbul
Dans cet article, Jean-François Pérouse expose les difficultés à qualifier l’identité des Kurdes d’Istanbul. Selon ce dernier, on peut y être « kurde « de naissance », par la langue maternelle, par l’appartenance politico-culturelle et/ou par le cœur ». En résulte, des difficultés à produire des statistiques fiables sur cette population ― faute de données ou d’enquête précise ― mais aussi des fantasmes souvent liés à des simplifications extrêmes et des manipulations statistiques. Le directeur de l’Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul rappelle également qu’il n’existe pas un seul vote kurde à Istanbul, mais des votes différenciés selon le statut des intéressés et les multiples réseaux d’appartenance. Tout comme il n’existe pas, selon lui, une seule communauté kurde, mais « une multitude de segments structurés par des liens de provenance géographique, d’affiliation politique, d’appartenance confrérique ou néo confrérique. »
Au début de l’année 2015, la métropole d’Istanbul compte officiellement un peu plus de 14 millions d’habitants. À cette population enregistrée s’ajoutent des dizaines de milliers de personnes non déclarées, intermittentes, passagères, dont des Kurdes de Syrie fuyant les horreurs de la guerre. En effet, selon les points de vue, on peut être kurde « de naissance », par la langue maternelle, par l’appartenance politico-culturelle et/ou par le cœur. Comme la Turquie n’offre plus de données sur la langue maternelle depuis le recensement de 1965 et qu’on ne dispose pas d’enquête large sur l’engagement et la revendication identitaire kurde à Istanbul, il ne reste que les chiffres sur le lieu de naissance. Si, début 2015, ce sont encore les deux tiers de la population enregistrée d’Istanbul qui sont nés hors de la province, la part des « provinces kurdes » ne dépasse pas 15 %.
Un comptage délicat, voire impossible
Issue des statistiques officielles turques sur les régions d’origine des Kurdes habitant Istanbul, ce comptage prête à d’infinis commentaires. Pourquoi avoir intégré les provinces de Sanliurfa et Siirt, qui comportent chacune de nombreuses populations arabophones ? Pourquoi ne pas avoir fait figurer Sivas (736 542 natifs installés à Istanbul en 2009), Erzurum (382 519), Erzincan (302 511), Kars (269 388), Elazig (141697) ou Gaziantep (78 238), qui comptent des Kurdes ethniques dans leur population ? En outre, beaucoup de natifs des provinces généralement décrites comme « kurdes » refusent d’être considérés comme tels ou en tout cas se reconnaissent plus dans la communauté politique turque que dans celle que le « mouvement kurde » prétend représenter.
En outre, ce mode de comptage exclut les Kurdes nés dans d’autres provinces que celles majoritairement kurdes, à l’instar de Konya, lieu d’exode dès l’époque ottomane, ou des agglomérations ayant enregistré d’intenses immigrations kurdes depuis des décennies, comme Adana ou Mersin, et ceux qui, nés à Istanbul, peuvent se revendiquer kurdes. Sans parler des provinces qui s’égrènent le long de la ligne de contact avec le Kurdistan géographique turc, soit la diagonale Ardahan-Erzurum-Erzincan-Sivas-Elazig-Malatya-Kahramanmaras-Gaziantep-Osmaniye. Sivas, le premier « fournisseur » de non Stambouliotes, a une population mêlée, et ses arrondissements orientaux comptent des kurdophones.
Autrement dit, les Kurdes géographiquement et statistiquement kurdes (critère de la province de naissance) ne sont pas tous ethniquement kurdes, et encore moins politiquement A l’inverse, les ethniquement kurdes ne le sont pas tous politiquement, pas plus que les politiquement kurdes le sont tous géographiquement (dans le cas des deuxième ou troisième générations, nées à Istanbul). Tant que ces modalités d’être kurde seront confondues, on demeurera dans l‘approximation, l’amalgame, la propagande, l’angélisme ou le vœu pieux (cela est valable pour Istanbul comme pour l’ensemble de la Turquie).
Par ailleurs, la présence de Kurdes à Istanbul ne se réduit pas à ceux qui sont enregistrés comme nés dans une province kurde. Elle est aussi le fait de Kurdes temporaires, attirés par le marché du travail stambouliote, comme par d’autres opportunités encore sans égal dans le reste du pays, notamment en matière d’éducation et de santé. Ces Kurdes, parfois jeunes – espérant gagner à Istanbul de quoi payer leurs études -, sont employés dans les segments les moins protégés : construction, vente au détail dans la rue, manutention/portage ou confection. Ils ont par ailleurs une grande visibilité sociale qui tient à la nature de leurs emplois, à la précarité de leurs conditions de logement comme à l’usage plus systématique qu’ils peuvent faire de la langue kurde.
Migrations et conflits de générations
L’histoire des migrations kurdes à Istanbul est ancienne. Les circulations de notables, de religieux, de soldats ou d’étudiants sont établies dès le début du XVème siècle. Pour l’histoire récente, deux vagues peuvent être distinguées, en partie à la lumière de la chronologie des créations d’associations de compatriotes, nombreuses à Istanbul. La première remonte aux années 1950-1970 et concerne les provinces des périphéries Nord et Ouest du Kurdistan turc : Malatya, Sivas, Tunceli, Erzincan, Kars ou Erzurum. La seconde remonte à la fin de la décennie 1980 et s’est poursuivie jusqu’au début des années 2000. Elle est directement ou indirectement liée aux violences qui ont déstabilisé et endeuillé le Kurdistan turc à partir de 1984 – date du début des actions armées du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) – où des milliers de villages et de hameaux ont été vidés pour « raison de sécurité » par les forces de l’ordre. Cette seconde vague, dénommée « migrations forcées » en turc, concerne davantage les provinces du cœur et de la périphérie Est et sud-est du Kurdistan (Siirt, Batman, Sirnak, Diyarbakir, Mardin, Van et Bingöl), mais n’exclut pas celles affectées par la vague précédente (comme Tunceli). Elle a alimenté une présence kurde à Istanbul a la fois plus visible, plus instable et souvent plus politique, compte tenu des traumatismes vécus. Composée majoritairement de ruraux, cette dernière vague a contribué a faire émerger dans les représentations dominantes une caractéristique de la population kurde : une forte natalité.
Macro-identités, micro-identités et absence de concentration territoriale
Dans le cas de migrants récents, pour trouver du travail ou un logement, ce sont plus les réseaux de provenance commune – sur la base du village ou de la province – qui sont utilisés que de supposés réseaux identitaires kurdes trop vastes et vagues pour avoir une quelconque efficacité. La « communauté kurde » d’Istanbul est donc mise à l’épreuve de la vie quotidienne et des pratiques d’accès à des ressources segmentées.
Quand on observe la situation au niveau des micro-identités et sur la base des statistiques relatives au lieu de naissance — donc en ne s’intéressant qu’aux Kurdes géographiques — on voit que chaque arrondissement d’Istanbul possède un profil différent. Les provinces kurdes d’origine qui dominent dans la composition de la population stambouliote varient selon les arrondissements : Adıyaman (7,4 % des personnes enregistrées dans le département et nées hors d’Istanbul) pour l’arrondissement de Sultangazi, Bingöl (4,1 %) pour Sultanbeyli, Ardahan (7,4 %) pour Esenyurt, Mus (5,4 %) pour Arnavutköy, Mardin (6,5 %) pour Zeytinburnu, Malatya (6,3 %), Bitlis (5,4 %) et Igdir (5,1 %) pour Basaksehir.
Par conséquent, n’en déplaise à ceux qui en recherchent absolument, au prix de simplifications ou d’amalgames, il n’y a pas de quartier kurde et encore moins d’arrondissement kurde à Istanbul. Les logiques de regroupement sont infra ethniques et les différences de position socio-économiques – souvent liées à l’ancienneté de l’installation – semblent plus déterminantes. Cependant, certains quartiers d’Istanbul sont emblématiques de 1a présence kurde, comme Çukur, Bülbül, Sehitmuhtar ou Tarlabasi. C’est par exemple dans ce dernier, secteur du vieux Beyoglu, que se concentrent des institutions culturelles et politiques phares du mouvement kurde : le Centre culturel de Mésopotamie et le siège du Parti démocratique des peuples (HDP). Toutefois, c’est plus la polarisation médiatique qui contribue à fabriquer ces « quartiers kurdes » que les réalités démographiques ou électorales.
L’absence d’un vote et d’une politique kurdes
Il n’existe pas un vote kurde, mais des votes différenciés selon le statut des intéressés et les multiples réseaux d’appartenance. La majorité des Kurdes « géographiques » soutient des partis autres que ceux issus du mouvement kurde. Nombre de maires du Parti de la Justice et du développement (AKP) des 39 arrondissements d’Istanbul sont des Kurdes géographiques et ethniques.
Les formations politiques savent le poids déterminant d’Istanbul dans les résultats finaux au niveau national et concentrent donc une part importante de leurs efforts sur la métropole. La stratégie du HDP est d’essayer de s’adresser aux « Kurdes de cœur » qui ne sont pas des Kurdes géographiques ou ethniques. Les résultats au scrutin présidentiel du 10 août 2014 montrent que le candidat du HDP, Selahattin Demirtas, a réalisé des scores honorables dans des arrondissements à faible population kurde, comme Adalar (13,8 %). En ce sens, les partis kurdes légaux sont partagés entre le souci de conforter la « communauté kurde » (imaginée) – en exaltant les caractéristiques communes : langue, histoire, territoire d’origine – et celui, plus récent, de s’adresser à une communauté politique plus large en dépassant toute segmentation à base ethnique et la tentation générale à tous les partis de Turquie d’instrumentaliser les réseaux de solidarité structurés à l’échelle des provinces.
Parallèlement, les Kurdes géographiques et ethniques continuent de jouer un rôle clé dans l’expression religieuse non étatique. Lors des manifestations d’octobre 2014 contre la politique du gouvernement turc — qui refusait alors d’intervenir contre les forces de l’organisation de l’État islamique — vis-à-vis de la ville syrienne de Kobané, comme pendant les rassemblements contre l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, on a vu au premier plan des groupuscules islamistes animés essentiellement par des Kurdes (au sens géographique et linguistique) faire le coup de feu contre des Kurdes du mouvement politique ou contre des symboles de celui-ci. On sait que le Kurdistan a été un sanctuaire de l’islam confrérique lors des décennies de politique antireligieuse des premiers temps de la République, fondée en 1923. Cette fidélité kurde au religieux se perçoit fortement à Istanbul et alimente certains discours de défiance dans les milieux laïques. En d’autres termes, les pires ennemis du mouvement kurde à Istanbul, comme dans le reste de la Turquie, sont des Kurdes géographiques et ethniques.
Fin d’une stigmatisation et affirmation identitaire
Qualifiés encore « d’Orientaux » ou de « bronzés » par ceux qui se considèrent comme d’anciens Stambouliotes menacés dans leur position du fait de l’immigration interne ou par ceux qui revendiquent une identité turque distincte, les Kurdes ont longtemps été assimilés dans l’imaginaire stambouliote dominant à des migrants. Ainsi, contre des Kurdes géographiques les plus récemment arrivés ou les plus précaires par leur travail, leur logement et leurs revenus, des formes de stigmatisation et de discrimination sont encore repérables. Mais, en aucun cas, on ne peut parler de racisme, tant la majorité turque est composite et a de plus en plus conscience de l’être. Cependant, l’afflux de réfugiés syriens à Istanbul depuis 2011 a eu pour effet de modifier la perception que les « non-Kurdes » pouvaient avoir des Kurdes de Turquie. Le sentiment de distance a changé d’objet. Il s’applique davantage aux migrants syriens, les immigrés kurdes nationaux apparaissant comparativement comme proches.
Par ailleurs, au fil des ans, en raison des mécanismes d’intégration et d’assimilation, comme à la suite des politiques d’ouverture conduites depuis la fin des années 1980, les premières vagues d’immigration se sont fondues dans le melting-pot stambouliote. La promotion sociale par l’éducation, l’insertion dans l’économie urbaine et dans les partis du système — en premier lieu depuis 2002 dans l’AKP — ont contribué à faire perdre aux Kurdes géographiques et ethniques leurs singularités perçues. À cette particularité subie s’est substituée une singularité assumée et revendiquée. À bien des égards, Istanbul a été un laboratoire important dans le processus d’affirmation identitaire positive des Kurdes en Turquie. Dès le début des années 1990, souvent en relation avec les communautés kurdes immigrées des pays d’Europe occidentale, Istanbul a été un centre de renouveaux identitaires, en art comme en politique. Associations, fondations et instituts ont porté ce processus de réélaboration et de revendication identitaire et facilité la redécouverte et la réappropriation fière des origines.
Aux mobilisations patrimoniales pour les langues et expressions culturelles kurdes se sont ajoutés des efforts pour écrire une histoire locale et transnationale kurde plurielle, longtemps broyée sous le récit national turc unique. Les maisons d’édition ont fleuri, de même que les revues et les lieux d’expression artistique. Mais depuis le début des années 2000, il semble qu’Istanbul a peu à peu perdu son statut d’exception comme foyer principal du renouveau culturel kurde. Ce réveil identitaire multiforme s’est en quelque sorte diffusé à l’ensemble du pays et s’est comme banalisé. Les Kurdes disposent désormais de rituels communautaires et d’un calendrier festif propre dont le point culminant est Newroz, le Nouvel An, qui marque le premier jour du printemps, le 21 mars. Les célébrations à Istanbul se partagent entre la célébration centrale du mouvement kurde qui rassemble des centaines de milliers de personnes, celles organisées par les multiples institutions kurdes, souvent concurrentes, et des festivités spontanées — généralement réprimées par les forces de l’ordre dans les zones marquées par la seconde vague migratoire.
Entre distinction identitaire et indistinction métropolitaine
Il n’existe pas une communauté kurde à Istanbul, mais une multitude de segments structurés par des liens de provenance géographique, d’affiliation politique, d’appartenance confrérique ou néo confrérique, qui ne peuvent momentanément converger qu’à de rares occasions ou sur peu de mots d’ordre.
Istanbul paraît à bien des égards l’illustration la plus flagrante de l’intégration des Kurdes dans le système turc. Citoyens turcs, ils participent pleinement à la vie politique, culturelle et économique de la métropole, sans distinction. Ce qui n’empêche pas qu’Istanbul ait pu jouer le rôle de laboratoire de la sauvegarde ou de la réinvention d’identités kurdes désormais promues sur le marché politique, culturel et économique. Mais les deux dynamiques ne sont pas incompatibles.
Donc l’étude des « Kurdes d’Istanbul » doit s’attacher à prendre en compte autant les dynamiques qui tendent à faire communauté que toutes les dynamiques de différenciation et de distinction qui travaillent les populations concernées. La communauté kurde n’existe qu’au prix de simplifications extrêmes et de manipulations statistiques — plus ou moins bien intentionnées — ou qu’au terme de rêves unificateurs incessamment brisés par le principe de réalité du quotidien métropolitain.