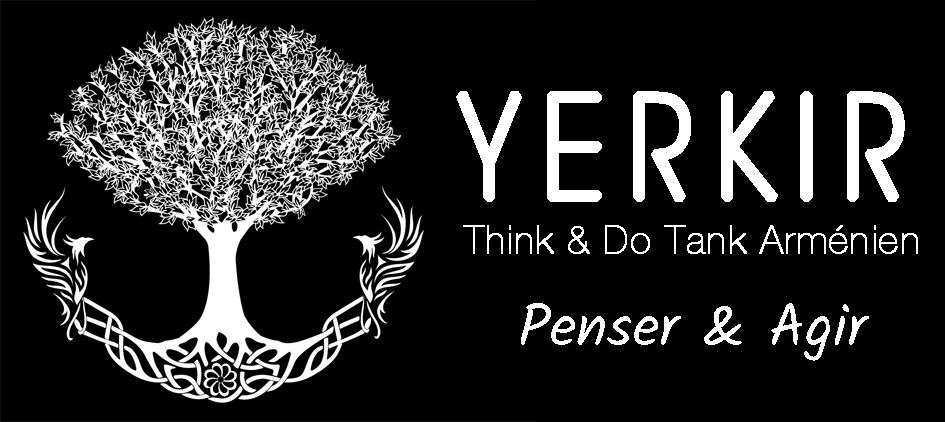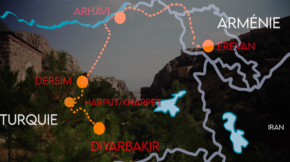Murat Paker
Psychothérapeute – Directeur du programme de Master “Psychologie clinique”, Université de Bilgi à Istanbul
Dans cette interview, Murat Paker revient sur la notion de traumatisme et notamment celle de « traumatisme social » qui convient autant aux Arméniens victimes du Génocide de 1915 qu’aux Kurdes et aux Alévis. Il insiste également sur l’importance du contexte sociopolitique global qui, selon lui, est déterminant dans l’apparition de traumatismes. Le psychothérapeute dresse ensuite le profil des auteurs de violence. Il aborde aussi les raisons qui ont poussé les élites ottomanes de l’époque à commettre un génocide et analyse les causes de sa négation qu’il situe au fondement même de la création de la République de Turquie. Enfin, revenant sur les conséquences du négationnisme d’État mis en place par les différents régimes en Turquie, Murat Paker constate que les travaux pionniers de quelques universitaires ont permis au mur de déni de se fissurer. Un processus très lent et qui doit aller de pair avec la résolution du problème turco-kurde, condition sine qua none selon l’auteur à « l’avènement d’une Turquie nouvelle ».
Les grands évènements de société peuvent-ils générer des traumatismes ? Est-il possible de parler de “traumatisme sociétal” ?
Le traumatisme est un phénomène qui peut se définir à plusieurs échelles, individuelle certes, mais aussi à l’échelle de divers groupes sociaux. Les effets s’observent tout aussi bien au niveau de l’individu et de la famille que de la société. Si une catastrophe de grande ampleur survient dans un village par exemple, le village entier se trouve traumatisé au niveau collectif. C’est cela que l’on désigne par “situation traumatique”.
Certains groupes sociaux et groupes ethniques peuvent également subir un traumatisme si leur identité est visée en particulier, sans que le choc soit nécessairement lié à un lieu. On parle généralement de “traumatismes liés à la violence politique”. Dans ce cas de figure, tous les membres du groupe se trouvent potentiellement affectés à des degrés divers. Dans le cas de la Turquie, il est possible de parler de traumatisme social pour les Arméniens, les Alévis ou les Kurdes. Si dans certains contextes ces groupes sociaux se trouvent pris pour cible à cause de leur identité sociale, le traumatisme qui en résulte est individuel mais également collectif.
Il existe des travaux sur les traumatismes vécus par les personnes victimes de violences, mais est-il possible de parler également de traumatisme en ce qui concerne les auteurs de violences ?
Quand on parle de “traumatisme”, il faut prendre en considération toutes sortes de situations comme les accidents ou les catastrophes naturelles. Si l’on s’en tient aux traumatismes causés par un tiers, il existe un large éventail de cas qui va d’une simple blessure au génocide. Il peut aussi s’agir d’“atteinte volontaire à l’intégrité d’autrui” (à l’échelle individuelle ou collective), de “coups et blessures”, d’“assassinat”.
Il est difficile de généraliser quant au ressenti des responsables du traumatisme. À ce stade, je préfère me concentrer sur le traumatisme résultant de violence politique en laissant de côté d’autres cas comme le vol ou l’extorsion de biens pour lesquels des dynamiques très différentes entrent en ligne de compte. Et même en se concentrant sur la question de la violence politique, c’est tout un nouvel éventail de situations qui se présente : les migrations forcées, les blessures, les menaces, les enlèvements, les meurtres politiques perpétrés au nom de l’État ou d’autres organisations, la torture, etc. ; des violences qui peuvent aller jusqu’aux massacres collectifs et aux génocides.
Les profils des auteurs de violences sont également très divers. Selon les études, un faible nombre de ces individus présentent des caractéristiques antisociaux, ou “psychopathologiques”, pour utiliser l’ancienne terminologie. Ces personnalités-là n’ont aucune capacité d’empathie avec ceux qu’ils considèrent comme “différents”. Ils ne parviennent à ressentir aucune émotion envers eux, ne ressentent aucun regret car leurs facultés ont été atrophiées ou ne se sont jamais développées (parfois à la suite de graves traumatismes pendant l’enfance). Le responsable du traumatisme qui présente des caractéristiques antisociales peut parfaitement continuer à vivre sans ressentir de peine ou de regret pour le groupe minoritaire. Pour les autorités ou le pouvoir en place, ces individus ont un profil idéal puisqu’ils peuvent facilement être manipulés.
Quant à la majorité des cas, les auteurs de violence se trouvent impliqués dans une situation à cause de leur position ou de leur rôle social. Au moment des faits, ils sont soit policiers, militaires, gardiens ou militants. Ils ont donc un rôle. On leur ordonne de faire telle ou telle chose, de détruire, brûler, blesser, tuer et ils exécutent les ordres car c’est leur devoir. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte en fonction de la gravité de la situation, mais surtout selon le degré de menace perçu.
Si les potentiels exécutants s’identifient au groupe menacé et qu’ils estiment que la menace est sérieuse, ils basculent alors facilement dans la violence et peuvent participer à toutes sortes d’exactions : destruction, incendies criminels, coups et blessures, tueries … Ils parviennent à rationaliser cette violence : « si ma communauté est menacée, je suis menacé également et je suis bien sûr prêt à me battre pour la défendre ». Ce type de raisonnement leur permet de rationaliser des violences extrêmes et c’est le cas de figure le plus fréquent. Parmi les membres du groupe, certains s’y adonnent avec fougue tandis que d’autres y répugnent mais s’exécutent malgré tout. Rares sont ceux qui refusent totalement d’y participer car le prix à payer est particulièrement lourd. En tant de guerre, on peut se retrouver face à un sentiment de culpabilité, se voir accusé de trahir la nation etc. Bref, des situations difficiles à gérer. Il s’agit d’une minorité, mais une partie réussit à s’opposer aux ordres ou choisit de s’enfuir. En période de guerre, si les désertions sont principalement causées par la peur, elles sont aussi motivées par le refus de faire « le sale boulot » comme c’est toujours le cas en temps de conflit. Les individus se retrouvent alors dans une situation particulièrement difficile et la fuite apparaît à certains comme la meilleure solution. Pour la majorité, en revanche, le prix à payer est trop lourd et les individus se mettent à rationaliser la situation d’une manière ou d’une autre.
C’est effectivement ce qui se passe au moment des faits, mais encore faut-il gérer la suite. Après les évènements, pendant la phase de normalisation, le climat sociopolitique général va déterminer le ressenti et le comportement des coupables et des auteurs des violences. Prenons les vétérans de la guerre du Vietnam… Ils sont partis au bout du monde pour défendre l’État américain. Ils se sont battus, ils ont connu des moments très difficiles, vécu toutes sortes de traumatismes pendant la guerre, ils ont été blessés et certains sont même morts au combat. Comment le justifier ? Ils disent qu’ils l’ont fait pour leur peuple, pour leur pays, pour barrer la route au danger communiste, etc. Quand ils sont rentrés au pays, l’atmosphère politique était très critique vis-à-vis de la guerre du Vietnam ; elle était de plus en plus condamnée et disqualifiée. Ils ont eu le sentiment d’avoir été utilisés, d’avoir énormément perdu, en vain.
Ils avaient survécu à toutes sortes de dangers, recouru à la violence, ils avaient même tué pour la collectivité et voilà qu’à leur retour, ils ne trouvaient aucun cadre pour donner du sens et rationaliser ces actes. Il était alors délicat de revendiquer quoi que ce soit au nom du militarisme ou du nationalisme américain. Leur malaise de l’époque les a poussés à remettre en question leur travail et a augmenté les risques de développement de troubles psychologiques. Même si les choses ne sont pas si tranchées, on peut tout de même supposer que si l’atmosphère sociopolitique avait été différente, si la société américaine avait continué de les porter aux nues, la majorité des anciens combattants auraient continué à rationaliser et à trouver du sens à leurs actes. Le ressenti des auteurs de violence peut donc changer du tout au tout selon le contexte politique ; il est inextricablement lié à l’interprétation que les milieux politiques et la société donnent aux évènements.
Dans les années 1919-1920, les Unionistes sont incriminés pendant une courte période, et les journaux de l’époque rapportent des débats au Parlement à ce sujet. Si la remise en question commence, elle ne dure pas et se trouve rapidement enterrée. Est-il possible de dire que la rationalisation des évènements s’est poursuivie faute d’un contexte propice à la remise en question dont vous parlez ?
L’année 1915 correspond à la fois à la chute de l’Empire ottoman et à la période de création, de construction de la République de Turquie. La « turquification » de l’Anatolie, son homogénéisation, l’élimination de toute différence… tout cela se déroule à cette période. Avant la Première Guerre mondiale, l’Anatolie abritait une population héritée de l’Empire ottoman dont 20-25% était chrétienne. Avec le « nettoyage » des Arméniens et des Roums, l’homogénéisation est patente. En l’espace d’un siècle, l’Empire ottoman s’est vu réduit comme peau de chagrin; il a perdu en autorité, en population et en richesse. Les pertes sont donc lourdes et l’élite ottomane se trouve repoussée dans ses retranchements. « Nous perdons systématiquement contre l’Occident, cette guerre est notre dernière opportunité, notre dernière chance de survie », voilà ce qu’ils se disent.
La cause de tout cela ? “Ces Chrétiens, ces non Musulmans que nous considérons comme nos citoyens, sont des traîtres”, “ils nous ont poignardés dans le dos en s’associant aux Occidentaux” pensent-ils. “Il nous faut donc mettre en place un Etat-nation homogène pour s’en protéger”. Mais comment s’y prendre ? S’impose alors progressivement l’idée d’une identité basée sur le triptyque “turc-musulman-sunnite”. L’atmosphère est extrêmement alarmante : le contexte de guerre apparaît comme un prétexte “pour régler le problème et faire le vide”. Cette peur de la différence s’est diffusée et ancrée dans la société : “Si notre peuple est pluriel et hétérogène, nous finirons par éclater et disparaître” pensait-on. Le nationalisme turc a trouvé la formule de l’homogénéisation culturelle pour apaiser cette peur viscérale.
Cette formule est utilisée pendant toute la Première Guerre mondiale, le nettoyage a lieu et la République de Turquie se construit sur cette base. Une fois créée, la République continue d’y avoir recours puisqu’elle construit son identité à partir de l’idéologie nationaliste turque. Tous les éléments qui ne sont par turcs-sunnites se trouvent exclus : les Arméniens et les Roums sont les premiers concernés, mais c’est aussi le cas, dans une moindre mesure, pour les Alévis et les Kurdes. Les premiers sont considérés comme des “étrangers de l’intérieur” ; les seconds sont vus comme des éléments à assimiler rapidement, à turquifier, à transformer en citoyens acceptables… Ce réflexe continue donc de se manifester durant la décennie suivante. Si l’on avait interrogé et remis en question toutes les dimensions des évènements de 1915 dans les cinq ou dix premières années de la République, ce sont les fondements mêmes de la République que l’on aurait remis en question.
C’est à ce moment-là que la négation se cristallise ?
Tout à fait. À cette époque, une grande partie de la population sait ce qui s’est passé : nombre de citoyens ordinaires et presque toute l’élite politique est au courant. Une partie de cette élite est d’ailleurs elle-même coupable, et elle reste en poste sous la République. Une autre partie de cette élite qui fonde la République n’est peut-être pas directement impliquée, comme Mustafa Kemal par exemple. Elle n’a peut-être pas de sang sur les mains, mais elle partage la vision d’un Etat-nation homogénéisé, fondé sur la turcité. Ils n’ont peut-être pas les mains aussi sales que les assassins, mais ils font partie de la même mouvance idéologique.
Ce qui se joue à ce moment-là, c’est la peur d’imploser en cas de remise en question?
Après cent ans de décomposition du territoire de l’Empire règne l’angoisse de la disparition totale. Pour calmer cette angoisse, les élites ont trouvé le nationalisme turc et s’y s’accrochent désespérément. Cette idéologie jette les bases d’un Etat-nation fondé sur la turcité. Les dirigeants s’y agrippent coûte que coûte, mais le tout est si superficiel, si forcé, si éloigné de la réalité sociologique et historique que c’est difficilement soutenable… Ils voient un peu la situation comme un vêtement trop étroit dont on ménagerait la couture pour éviter qu’elle ne se déchire : toute interrogation, toute acceptation des faits risquait de faire éclater l’ensemble… C’est un vêtement si étriqué, si mal cousu qu’ils n’ont pas complètement tort sur ce point. Aux yeux de l’élite républicaine, le mieux à faire à ce stade, c’est de recouvrir le tout sans trop y toucher.
Ils refusent peut-être d’y toucher, mais le problème n’en est pas résolu pour autant.
Il revient comme un fantôme qui nous hante.
Est-ce qu’il s’agit du même “fantôme” pour les populations de la Turquie d’aujourd’hui ? Que peut-il se passer à la découverte d’un évènement caché depuis si longtemps ?
La génération des premières années de la République est au fait des évènements, mais les générations suivantes sont éduquées dans le déni par l’Éducation nationale et les médias pendant des décennies. Quand les actions de l’Asala (Armée secrète arménienne de libération de l’Arménie, Ndlr.) des années 70 ramènent les évènements à l’ordre du jour pour l’opinion publique, la majorité de la société en Turquie n’a aucune idée de la réalité. Les gens ne font pas semblant, ils ignorent véritablement les faits et c’est un choc pour eux. Le nationalisme turc et l’idéologie officielle des années 70 présentent les actions de l’Asala comme celles d’une “bande d’arméniens fous à lier qui agressent les Turcs”.
À cette période, la société en Turquie vit un traumatisme en prenant connaissance de la question arménienne et des évènements de 1915, et c’est sur l’Asala que se reporte ce traumatisme. C’est ainsi que le fantôme revient. C’est à ce moment que la population commence à s’interroger, à s’enquérir des raisons qui peuvent motiver de tels actes : “pourquoi nous tuer ?”, “qu’est-ce qu’ils nous veulent ?”. En réponse à cet élan, les autorités se mettent à nier et à diffuser les thèses de l’idéologie officielle pour contredire la thèse des Arméniens. C’est une nouvelle période qui commence, une période de négation active en comparaison avec la négation passive de la période antérieure, pendant laquelle rien ne venait troubler l’idéologie officielle.
Les évènements ont été mis de côté, on les a dissimulés et oubliés et voilà que quelqu’un tue nos diplomates et nous le renvoie en pleine figure via une propagande armée. Tout le monde s’interroge alors sur les raisons de telles actions et les officiels se mettent à mentir de façon plus active : “les Arméniens mentent, ils exagèrent les faits, c’était la guerre à l’époque et ce sont eux en réalité qui nous ont massacrés”. Nous entrons alors dans une phase de manipulation, de négation volontaire et plusieurs générations grandissent dans cette ambiance. En Turquie, plusieurs générations ont vécu ces périodes de négation active et de lavage de cerveaux. La situation devient, en conséquence, d’autant plus inextricable. De nos jours, nous sommes confrontés aux deux couches de problème : la première, cent ans d’omission, de déni passif faute de s’y intéresser ; la seconde, au moins trente ou quarante ans de négation réactionnaire et défensive, plus incisive depuis les années 70.
De nos jours, c’est la combinaison de ces deux niveaux de négation qui empêche la société de se confronter à son passé. Depuis une dizaine ou une quinzaine d’années, des initiatives ont été lancées pour la reconnaissance et on découvre progressivement la vérité. Il n’y a encore rien sur le plan officiel, mais au sein de la société civile, des universitaires, des journalistes et des artistes lancent des initiatives non officielles qui conduisent progressivement à une reconnaissance.
Un certain nombre de personnes ont sans doute appris l’histoire de leur propre famille depuis une quinzaine d’années. Prendre conscience de la responsabilité de sa famille, comprendre que le capital familial vient peut-être de là… Cela peut-il créer un nouveau traumatisme pour les populations de la Turquie actuelle ?
C’est le contexte sociopolitique global qui est déterminant dans l’apparition de traumatismes. L’atmosphère peut par exemple justifier l’aspect fondamental du nationalisme turc, justifier les faits par le contexte de guerre qui “comme partout dans le monde, voit les perdants se soumettre aux plus forts”. Mais le ton peut se vouloir plus humain, plus juste et encourager “à respecter les douleurs de l’autre”, à essayer de le “comprendre” car “nous sommes tous des êtres humains”; expliquer qu’il nous faut “être solidaires”, interroger “notre histoire et reconnaître le passé au nom de la civilisation et de l’humanité”. Si le contexte politique correspond au deuxième exemple, je risque d’avoir honte en découvrant ce qu’a fait mon grand-père. L’idéologie officielle de la Turquie actuelle est toujours très orientée par le nationalisme turc et c’est progressivement l’idéologie officielle islamique qui gagne du terrain.
Le sunnisme et les Musulmans sont au cœur de l’idéologie turco-islamique. La turcité était déjà centrale, mais le sunnisme et l’Islam y sont de plus en plus associés. Ces termes étaient déjà dans les discours, mais avec l’AKP au pouvoir, ils sont désormais plus systématiquement combinés depuis une dizaine d’années. Tout est évalué en rapport avec ces identités, et c’est pour cela qu’une majorité de la population, les hauts fonctionnaires et les élites politiques considèrent le reste du monde sous ce prisme. La politique étrangère fonctionne exactement comme ça puisqu’elle se structure autour de la désignation d’“amis” et d’“ennemis”, sans qu’il soit question de parler sur un pied d’égalité.
Parler des évènements aide-t-il à cicatriser les blessures ?
Cela crée au moins quelques fissures et c’est très important. Jusqu’à présent, nous étions face à un mur de béton armé, un mur de déni : dans les publications, dans différents projets et travaux, dans des conférences, dans des programmes télévisés… Mais ce mur de béton s’est fissuré grâce aux travaux pionniers de quelques universitaires. L’information commence alors à filtrer, les gens y ont accès ainsi que les organes de presse. Avec Internet il suffit de parler des langues étrangères pour accéder à toutes sortes d’informations. En comparaison aux années 70-80, on peut dire que la population est bien plus informée, a plus de possibilités d’accéder à d’autres sources, mais précisons que cela reste limité à un niveau non officiel. Ce phénomène va se poursuivre et les fissures finiront par envahir ce mur de béton armé qui finira par s’effondrer. Mais cela prendra du temps et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. C’est un mur particulièrement résistant et son effondrement sera aussi synonyme d’autres interrogations sur la philosophie de la création de la République, sur ses fondements, etc. Beaucoup en ont conscience et c’est pour cela qu’ils s’évertuent à boucher ces fissures, à empêcher les fuites afin d’éviter l’effondrement du tout.
Il y a un autre facteur qu’il faut aussi aborder, c’est la question kurde. En Turquie, la question kurde est un sujet brûlant, beaucoup plus actuel que la question arménienne. Si la question kurde se résout véritablement de manière satisfaisante pour les Kurdes, alors l’État turc devra assouplir sa vision uniformisante de l’identité. On ne dira plus que toutes les populations vivant en Turquie sont “turques”. Il faudra trouver une autre formule, comme “de Turquie” ou “citoyen de la République de Turquie”, pour rassembler toutes les cultures sous un même drapeau. Ce n’est pas facile car il y a de nombreuses résistances, mais si la Turquie y parvient une étape décisive sera franchie. C’est un processus qui devra se faire parallèlement à la démocratisation.
Pour pouvoir arriver à une étape satisfaisante dans la résolution du problème turco-kurde, ce qui semble mal engagé, la Turquie doit au préalable interroger de manière systématique la raison même du problème kurde. On doit avant tout reconnaître ce que cela révèle des faits et de la nature de l’État. Il sera alors possible de résoudre la question turco-kurde et ce sera l’avènement d’une Turquie nouvelle. Une Turquie plus tolérante, mature et démocratique. C’est à ce moment-là qu’il sera possible d’aborder la question du génocide arménien de 1915, de le reconnaître et de digérer ce traumatisme.
Traduction du turc au français Céline Pierre-Magnani