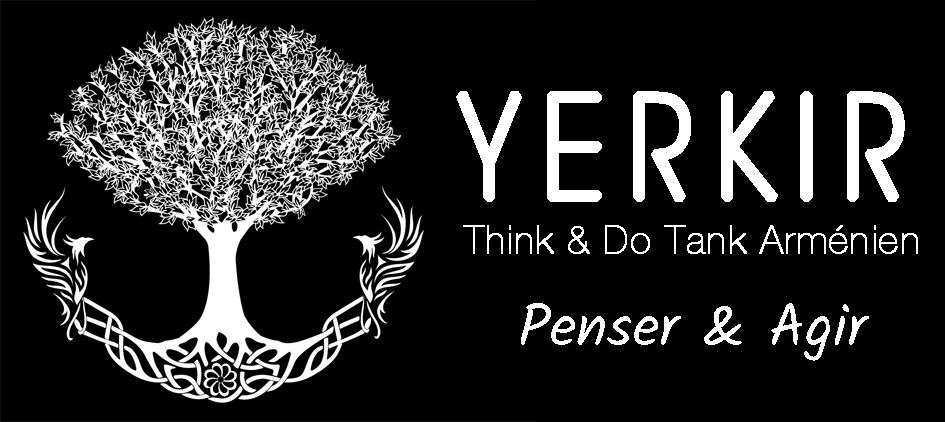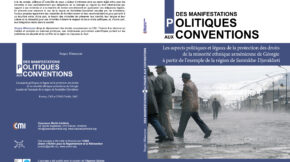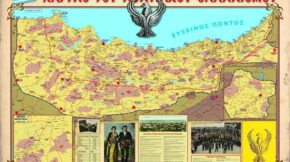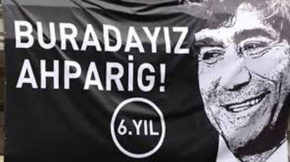Ceux qui, secrètement, espèrent trouver dans les mémoires des ex-chefs Unionistes l’expression d’une confession intime sur le génocide des Arméniens (1915-1916), d’un aveu associé à un regret, seront déçus. L’historien qui travaille sur ces mémoires et sur ces hommes, doit quant à lui absolument s’interdire une telle quête, non seulement parce qu’elle serait vouée à l’échec, mais parce qu’elle est téléologique, orientée et anti-scientifique. Chercher à apercevoir un rougissement de « honte » sur le visage des Unionistes trahirait une volonté d’évaluer la distance entre « eux » et « nous », autrement dit, d’évaluer leur humanité. Or, d’emblée, il faut voir en ces hommes, des hommes.

Cet article analyse la responsabilité des universitaires dans un domaine d’études où des groupements d’intérêt, non seulement turcs mais du monde des affaires et du gouvernement américains, se sont agressivement employés à maintenir de façon systématique et institutionnalisée un dogme académique fait de contrevérités et demi-vérités, d’omissions, de passages sous silence, d’obscurantisme et de déni. Les ravages n’ont pas tant affecté le champ même des études sur le génocide – où de nombreux spécialistes ont pu démystifier le credo du discours négationniste – que celui des études ottomanes et turques. Dans ce champ d’études historiquement aveugle aux génocides finaux de l’Empire ottoman, le négationnisme s’est normalisé et formalisé en un discours construit, devenant ainsi une source d’ambiguïté morale diffuse parmi les universitaires, avec ou sans leur pleine connaissance des enjeux ou leur approbation des stratégies de réduction au silence.

Dans cet article, Seyhan Bayraktar, qui a mené des recherches sur la rhétorique développée en Turquie autour du Génocide arménien, explique qu’une augmentation quantitative de discours n’indique pas nécessairement un changement paradigmatique vers une parole autocritique. Partant des années 70, elle décrit les diverses mutations du négationnisme de l’État turc à travers les décennies. D’un négationnisme de réaction, on passe progressivement à un autre, plus proactif. Selon l’auteure, on assiste à une institutionnalisation et à une professionnalisation du négationnisme. Aussi, les années 2000 se révèlent être une période de transition pendant laquelle la « question arménienne » s’inscrit progressivement dans le débat politique turc puis entre progressivement dans la communication politique quotidienne de la Turquie avec le 90ème anniversaire du Génocide. Une période délicate pour la Turquie, en pleines négociations d’entrée dans l’Union Européenne…