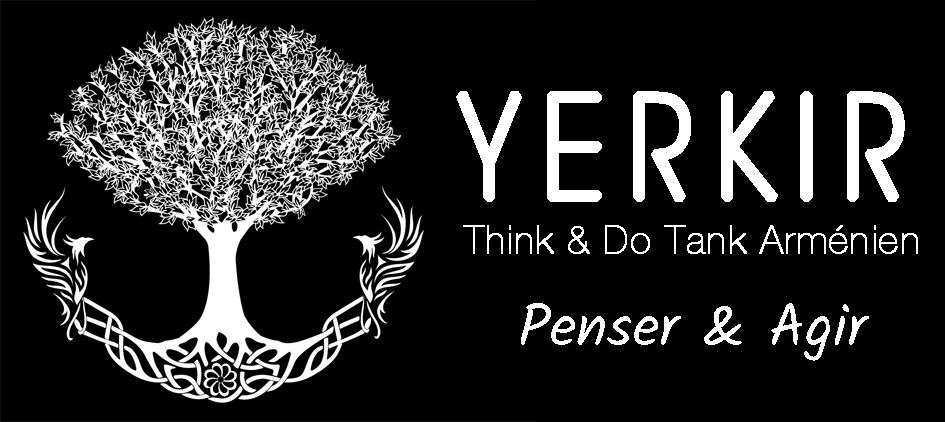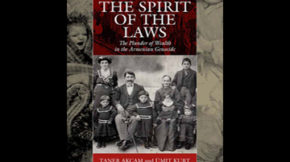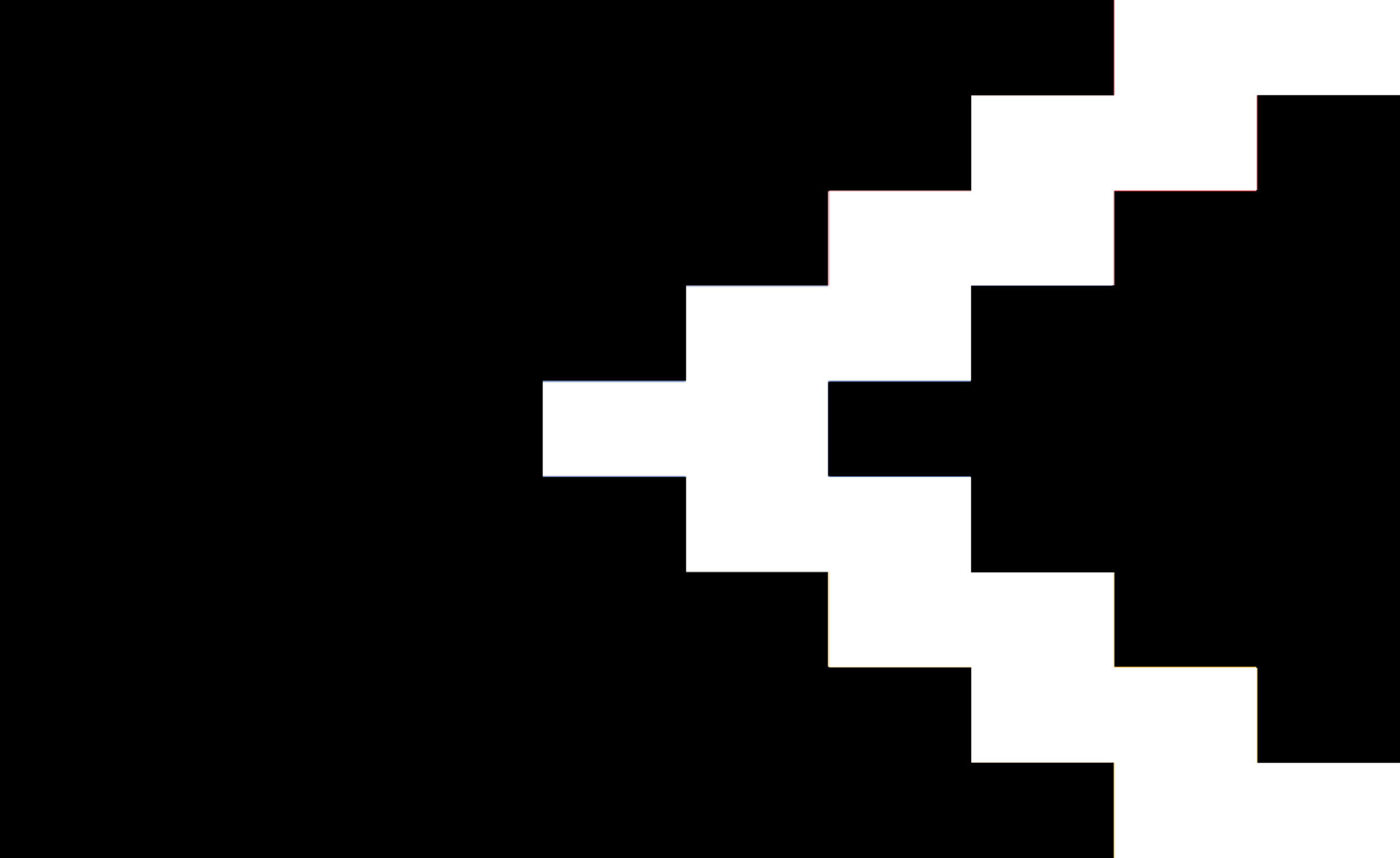Laurent Leylekian
Laurent Leylekian fut rédacteur puis directeur de publication du journal France-Arménie jusqu’en 2010. Il a également a dirigé la Fédération Euro-Arménienne à Bruxelles de 2001 à 2010 où il a notamment participé à la remise en place de la question arménienne au sein des négociations d’adhésion de la Turquie. Il continue à prendre une part active à divers projets de la société civile en marge de ses activités professionnelles.
Voici bientôt quinze ans que la Turquie est candidate à l’adhésion à l’Union européenne. Une durée qui, à elle seule, vaut constat d’échec. L’adhésion ne s’est pas faite mais si d’aventure elle se réalisait, sa signification comme sa portée serait très éloignées de celles que l’on s’en faisait en 1999, lorsque le statut de pays candidat lui fut accordé.
Avant d’examiner l’évolution funeste du projet européen — et, pour ce qui nous concerne, la place de la question arménienne en son sein — allons directement à la conclusion : la Turquie européenne ne se fera pas car il s’agit à proprement parler d’un contresens, c’est-à-dire d’une idée qui porte en elle sa propre contradiction. La Turquie s’est construite comme la négation de l’Europe et son adhésion ne pourrait signifier que la disparation d’un ou de l’autre des deux termes de l’équation. En l’occurrence, la Turquie n’a pour l’essentiel pas changé depuis 1915 et, à moins qu’elle ne change, son adhésion à l’Union européenne signifierait simplement que l’Europe n’existe plus en tant que projet politique.
L’Europe, une appartenance culturelle
Historiquement et géographiquement parlant, la notion d’Europe est âprement discutée. « Petit cap de l’Asie » selon la formule célèbre de Paul Valéry, ses frontières orientales sont floues. Si, à l’instar du Général De Gaulle, la plupart la limite à l’Oural, certains préfèrent qu’elle se termine à la Volga. Au Sud-est, on considère généralement qu’elle s’arrête au Caucase mais beaucoup intègrent les Arméniens et les Géorgiens parmi les Européens. Au Sud, on estime actuellement que les Balkans, la Grèce et même Istanbul sont des villes européennes mais, il y cent cinquante ans, l’Orient commençait après Vienne.
En fait, il existe une forte tradition intellectuelle qui fait de l’Europe un continent de l’Esprit. L’Europe, ce serait cet endroit où opérèrent successivement plusieurs « miracles » par ailleurs inédits de l’Histoire humaine : au minimum la philosophie grecque et cette théologie du libre-arbitre que fut le christianisme, et au choix, la Renaissance et la Réforme, et/ou Les Lumières, la révolution industrielle et son corollaire politique, la Révolution française.
De cette histoire, les Turcs furent largement absents mais cela ne suffit pas à les exclure de la famille européenne. Après tous, la Renaissance et les Lumières touchèrent surtout la partie occidentale de notre continent et n’attinrent que peu ses zones les plus septentrionales ou la rive droite du Danube. Pourtant, nous considérons sans conteste les Serbes ou les Finlandais comme européens. Au demeurant, la fracture entre catholicisme et orthodoxie fut longtemps structurante dans l’histoire du continent sans que nous en fassions aujourd’hui un critère d’européanité ou de non-européanité (et à ce compte-là les Arméniens ne seraient européens que du bout des lèvres). Enfin, si l’Europe elle-même s’est souvent identifiée à la Chrétienté combattante face aux tentatives de submersion par l’Islam — l’une des premières mentions du mot « Europe » portant cette signification politique est attestée à la bataille de Poitiers (732) — on ne peut pas dire qu’elle fasse pleinement sens aujourd’hui sur notre continent largement frappé d’athéisme et comportant de fortes minorités musulmanes, voire des pays qui furent façonnés en grande part par l’Islam comme l’Albanie ou la Bosnie.
Arrivés en Asie mineure au tournant du premier millénaire, les peuples turcomans auraient très bien pu s’intégrer aux nations européennes comme le firent les Magyars ou les Bulgares qui les précédèrent de peu à l’échelle de l’Histoire. Ils l’auraient pu d’autant plus que ceux que l’on appelle aujourd’hui « turcs » descendent de 700 000 turcomans venus d’Asie centrale qui firent souche avec les quelques cinq millions de personnes qui peuplaient déjà l’Asie mineure, au premier chef desquels les Européens qu’étaient un peu les Arméniens et beaucoup les Grecs. En quoi les Turcs ne s’européanisèrent alors pas mais, au contraire, orientalisèrent profondément les peuples qu’ils assimilèrent ?
L’Europe, une identité politique
La réponse à cette question requerrait à elle-seule un livre entier. Au risque de paraître sans nuance, on peut cependant dire que la Turquie n’est pas européenne car ses dirigeants politiques ont toujours refusé une éthique qui aurait conduit — même hors du champ politique — à l’émergence d’une pensée autonome. De même que sur la propriété foncière, le padishah imposait son empire absolu sur les âmes. Ce que les Sultans ne voulurent jamais, c’est l’émergence de cette raison normative qui n’aurait pas été inféodée au dogme politique ou religieux et qui fait véritablement l’Occident.
En vérité, il y eut pourtant bien deux tentatives de faire de ce pays, à travers la réforme de ses mœurs sociales et politiques, un Etat européen. Mais la première échoua et la seconde fut un dévoiement. Les Tanzimat, se brisèrent sur les forces dominantes du corps social ottoman qui refusèrent dans un même mouvement, et les réformes structurelles de l’empire, et l’octroi d’une égalité de droit à ses sujets non musulmans. La Turquie n’a jamais connu, sinon la lettre, du moins l’esprit de ce que purent être les divers édits de tolérance, la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ou le décret Crémieux.
La seconde tentative — que je qualifierais volontiers de dévoyée — fut celle des Jeunes-Turcs et de leurs héritiers, les kémalistes. Les Jeunes-Turcs préfigurèrent ce que feront peu après les fascistes ou les bolcheviques: fondamentalement, ils adoptèrent les outils de la modernité européenne en rejetant la philosophie politique qui les sous-tendait, le progressisme qu’il soit d’essence libérale ou sociale-démocrate. Ce n’est pas un hasard si, juste avant la première guerre mondiale, les Jeunes-Turcs liquidèrent les derniers libéraux musulmans de l’Empire comme Mahmud Chevket. Quant au Génocide des Arméniens proprement dit et à l’expulsion consécutive des Grecs, ils constituèrent littéralement le meurtre de ceux qui incarnaient la part européenne de l’Empire : ceux qui y avaient introduit les innovations techniques occidentales mais également, à travers des pratiques sociales inédites — le sport, le théâtre par exemple et cette fameuse raison critique bien sûr — l’âme européenne.
En assassinant les Arméniens, la Turquie a tué ce qu’il y avait d’européen en elle, exactement comme les nazis s’exclurent de la civilisation européenne par le meurtre des Juifs. Mais, comme pour l’Allemagne, il n’y avait rien-là de définitif pour la Turquie. Cependant, l’avènement kémaliste — c’est-à-dire la continuation délibérée du projet politique des Jeunes-Turcs — a en quelque sorte entériné ce choix. En promouvant des criminels du régime précédent, en continuant par la force son œuvre de destruction des peuples d’Asie mineure et en mettant en place un négationnisme d’Etat valant oblitération des différentes composantes de son passé et de son crime, l’Etat turc signifie très clairement la permanence de son rejet de l’Europe et de ses valeurs.
Nous n’unissons plus des hommes, nous coalisons des Etats
Nul responsable politique pétri de l’esprit européen n’aurait pu imaginer octroyer un jour le statut de candidat à un tel pays ; même sous la pression de raisons géopolitiques internes ou venues d’outre-Atlantique. Il est tout sauf anodin que cet octroi n’ait été possible qu’après la dernière Commission véritablement européenne incarnée par le troisième mandat de Jacques Delors (et quoi que dise le Delors d’aujourd’hui à propos de la candidature turque) : c’est à peu près à cette époque que la conception politique de l’Europe a cédé le pas à une mécanique institutionnelle sans âme.
Les raisons de cette perte de sens sont multiples, desquelles l’aspect générationnel n’est pas le dernier : Pour reprendre l’exemple des derniers présidents de la Commission, Delors avait quinze ans en 1940, Barroso en avait treize en 1968. A l’exigeante responsabilité historique d’un personnel politique cultivé et marqué par deux conflits cataclysmiques, succédèrent les caprices libertaires et amnésiques de leurs héritiers. La collusion entre l’illusion libérale qui prévalait à l’Ouest et la désillusion postcommuniste qui régnait à l’Est fut sans doute le plus grand malentendu européen des 25 dernières années : si le Grand Elargissement de 2004 était historiquement nécessaire, sa conduite à la hussarde se fit au sacrifice explicite de toute vision. Au refus spatial des frontières géographiques correspond très exactement le refus temporel de la mémoire historique ; c’est-à-dire le refus de toute affirmation identitaire. Et dans une même geste, les citoyens français et néerlandais qu’on eut la désinvolture de consulter refusèrent et le contenu ultralibéral et le contenant sans limite d’un Europe désincarnée qui, à l’inverse du dessein de Monnet, n’unit plus des hommes mais coalise des Etats.
Nul doute que dans ces referenda perdus de 2005, la question turque joua un rôle prépondérant comme le montrèrent avec constance plusieurs sondages d’opinion. Depuis, alors que l’Europe s’enfonce toujours plus dans une crise dont l’aspect économique n’est que l’écume, la question de la Turquie ou celle du génocide des Arméniens — c’est la même — jouent un rôle très précis, celui de marqueur des avancées et des reculs de l’idée européenne. Ceux qui brandissent le préalable de la reconnaissance du génocide se prévalent d’une certaine idée de l’Europe, continent de l’Esprit ; ceux qui voient la Turquie au filtre avantageux de critères techniques et de données statistiques défendent l’Europe-monde, celle du traité de Vienne où, effectivement, la Turquie peut légitimement jouer sa partition au gré de ses intérêts. Ces deux visions sont présentes à gauche comme à droite et l’exigence de reconnaissance du Génocide ou les velléités un peu honteuses de son oblitération aussi.
Cependant, il est malheureusement à craindre que les héritiers de Romain Rolland, de Stefan Zweig, de Rainer Maria Rilke, de Ferdinand Pessoa ou de Paul Valéry aient provisoirement perdu le combat et que cette Europe de l’Esprit ontologiquement hors d’atteinte de l’Etat turc se soit évanouie. Ce qui semble se préparer à court terme, c’est l’Europe des nationalismes dont on sait ce qu’elle donna et où le régime d’Ankara ne détonne pas plus que celui de Moscou, que celui de Minsk, ou que ces sociétés « européennes » où prospérèrent les Croix de feu, le Stahlhelm, les Squadristes… ou les Loups-Gris. Quelque part, cette Europe a déjà adhéré à la Turquie.