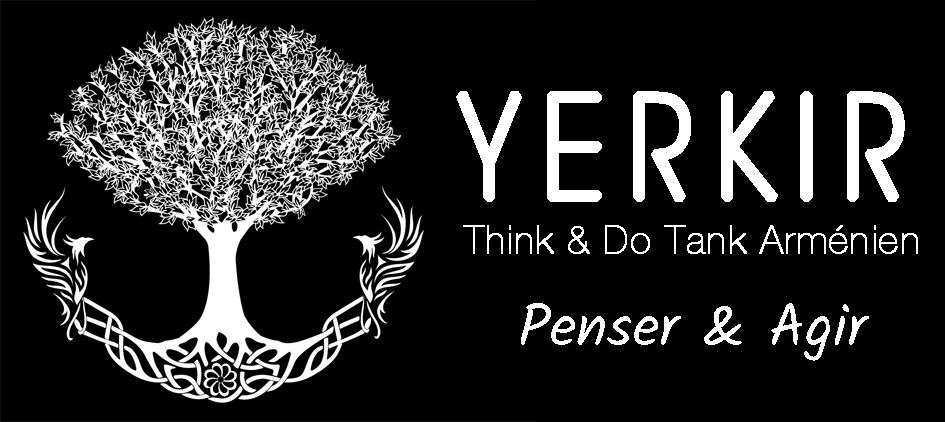Vahan Kerovpyan
Musicien au sein du collectif Medz Bazar
Vahan Kerovpyan, 30 ans, est musicien au sein du Collectif Medz Bazar. Formé en mai 2012, ce dernier se compose de huit musiciens de différentes origines (française, arménienne, turque, américaine) qui (ré)interprètent musiques traditionnelles et jouent leurs propres compositions originales. Dans cette interview, Vahan Kerovpyan revient sur ses différents voyages en Turquie et en Arménie et donne son ressenti sur les Arméniens vivant dans ces deux pays ainsi que sur la société civile turque. Il commente également les paroles des chansons du Collectif Medz Bazar et fait part de sa vision de l’avenir des Arméniens en Diaspora et ailleurs. Un discours plutôt positif qui tranche avec le pessimisme ambiant d’une partie de la communauté qui pense que l’identité et la culture arménienne sont en train de disparaître à jamais.
REPAIR : Quelles sont vos origines parentales ?
Vahan Kerovpyan : Mon père vient d’Istanbul et ses parents sont stambouliotes également, mais mes arrière-grands-parents paternels sont de quatre coins différents d’Asie Mineure. Ma mère, elle, est moitié arménienne, moitié américaine, elle est née aux États-Unis et ses grands-parents maternels sont de Kessab en Syrie. Du côté de son père, les origines sont surtout anglaises, un peu écossaises et un peu alsaciennes. Je suis un bon mélange.
Vous avez participé à la vie de la communauté arménienne très jeune…
J’ai été assez impliqué dans le milieu associatif à Paris, notamment dans l’Organisation Terre et Culture et au sein de l’atelier éducatif franco-arménien MGNIG dont j’ai fait partie dès l’âge de cinq ans, soit depuis sa création en 1990. J’étais parmi les premiers enfants à fréquenter cet atelier, et j’y ai passé tous mes samedis depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. C’est un véritable cercle d’amis, un lieu où on joue, pense, crée, en langue arménienne ; où on grandit ensemble en partageant beaucoup de choses, avec cette langue comme base commune. Ça m’a bien sûr donné une base solide au niveau linguistique, mais c’est aussi à MGNIG que j’ai connu certains de mes amis les plus intimes. Plus tard je suis passé du côté des « adultes », pour animer des sessions de langue et de lecture, ainsi que des ateliers de théâtre, de sketchs et de musique.
Quels liens entretenez-vous avec la Turquie ?
J’ai eu une période, entre 2006 et 2010 où j’y allais très souvent… aussi souvent que possible. Ça a été une révélation.
Pourquoi ?
Premièrement, Istanbul est la ville où mon père est né. J’ai de la famille là-bas. Ensuite, j’y ai rencontré beaucoup d’Arméniens qui sont devenus des amis proches et à travers eux j’ai rencontré des Turcs, des Kurdes… Durant toute cette période, mes sœurs et moi nous sommes fait beaucoup d’amis et fréquentions pas mal certains milieux progressistes d’Istanbul. Puis en 2008, nous avons effectué, avec quelques amis, notre premier voyage à l’Est, sur les terres ancestrales…
Qu’avez-vous pensé de ce voyage ?
Ça m’a bien bouleversé, comme beaucoup d’autres je pense. Ça a pas mal chamboulé mes repères, même si je trouve que ces derniers étaient assez souples dès le départ, ce qui, je pense, doit souvent être le cas de descendants d’Arméniens d’Istanbul. Chez ces derniers, il n’y a pas seulement la notion de « la Turquie comme ennemie », mais aussi, la Turquie comme le lieu où sont nés le père ou la mère ; avec des bons souvenirs, des gens réels, pas seulement vue comme une sorte de monstre. Mes repères étaient donc plus ou moins ouverts, mais quand même nourris de ce qu’on apprend en diaspora. J’avais donc une appréhension et, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui se confirment.
Que voulez-vous dire ?
Il y a une haine très présente. Au niveau de l’État, c’est clair et net qu’il est toujours sur la même position. Et puis il y a la douleur d’être à la rencontre de quelque chose qui nous échappe complètement. Par exemple, de voir des ruines, de voir une fontaine avec des inscriptions en arménien ou même de voir une grand-mère qui parle arménien… des situations comme celles-ci qui mettent un peu tout à l’envers car c’est de l’abstrait qui devient concret tout à coup. Et cette réalité qui arrive subitement, on ne sait pas quoi en faire au début. D’où mes allers retours là-bas.
D’année en année je vivais les choses différemment en voyageant avec des gens différents à chaque fois. Mais on a fini par concrétiser des choses. Au début, il s’agissait surtout d’une sorte de repérage, puis avec mes sœurs et des amis, nous avons participé à la reconstruction des fontaines à Havav, avec les membres la Fondation Hrant Dink. Cela nous a permis de mettre un peu une main dans du concret, c’est-à-dire d’essayer de se sentir comme faisant partie de cette réalité et ne pas seulement être des sortes de témoins bizarres qui ne peuvent rien faire.
J’ai vécu une sensation similaire avec le Collectif Medz Bazar, l’année dernière, lorsque nous avons fait une tournée qui partait d’Istanbul et arrivait à Erevan et ses environs en passant par Elaziğ, Diyarbekir, Mardin Dersim… des villes que j’avais, pour la plupart, déjà visitées avant. Encore une fois ça m’a permis de sentir que je faisais quelque chose de vrai là-bas, que nous étions en contact avec des gens et que nous partagions ce que l’on fait. Ce sont des petites choses comme ça qui ont aidé à rendre l’expérience plus terre à terre.
Quelle vision de la Turquie aviez-vous avant de vous y rendre ?
Déjà il y avait la peur que ce soit dangereux. Et en effet, je pense que si on ne fait pas attention, en tant qu’Arménien, on peut se retrouver dans des situations pour le moins désagréables même si maintenant la situation est bien pire pour les Kurdes. Mais il y a quand même des gens qui font peur (rires), ou des situations qui alimentent les peurs que l’on peut déjà avoir en tant qu’Arménien de diaspora. Cette peur, sur place, se transforme plus en une sorte de conscience, d’éveil, qu’il est bon de prendre en compte sans toutefois s’y soumettre complètement.
La Turquie, malgré tout ce qui m’y attire — et ce sont beaucoup de choses ! — reste un pays que je ressens globalement comme assez hostile. Dans les infos sur la Turquie il y a généralement peu de bonnes nouvelles. C’est un pays qui à la fois m’attire et me fait enrager, et ce, encore plus depuis que je le connais de l’intérieur. Aujourd’hui les résultats des élections, ou d’autres nouvelles de ce genre, ce sont des choses qui concernent des amis ; les bombardements à Diyarbakir ou ailleurs nous touchent plus car ce sont des endroits que l’on connaît désormais.
Suivez-vous l’actualité turque ? Si oui, comment analysez-vous l’évolution de la Turquie et notamment de la société civile ?
La situation est assez désespérante malgré tous les efforts que l’on peut voir. Des efforts en Turquie, il y en a toujours beaucoup eu. Malgré tout, c’est vraiment difficile d’avoir de l’espoir en une sorte de démocratie s’il n’y a pas un véritable changement de fond au niveau du régime…
Malgré les mouvements que l’on peut apercevoir au sein de la société civile ?
Ces mouvements, dont certains font preuve d’un très grand courage, sont marginalisés, voire écrasés. Ils doivent exister, il n’y a pas d’autres choix – à leurs risques et périls évidemment. Cela crée sans aucun doute un changement. Des gens vont gagner une conscience plus individuelle et moins nationale. Je pense et j’espère qu’il y a de plus en plus d’adhérents à une mentalité plus libre, des gens qui réussissent à penser par eux-mêmes sans être sujets à un dogme nationaliste ou islamiste, ou autre. Mais ces dogmes, mine de rien, dominent largement en Turquie car c’est une société complètement construite sur ces principes-là. C’est donc difficile d’être positif. Après, en étant pessimistes on n’avance pas non plus.
Comment voyez-vous les Arméniens d’Istanbul ?
J’ai l’impression qu’il y a plusieurs mouvances. Si certains, à l’image de Hrant Dink, s’exposent à la société et au pouvoir par leurs actions politique, militante ou culturelle, beaucoup sont tout à fait discrets et silencieux. Je ne pense pas qu’on puisse les juger comme étant des gens peureux car, en effet, c’est un pays, un régime et une société qui les met sous pression. Nous ne sommes pas bien vus donc, soit on fait de la résistance active, soit on fait de la résistance passive, ce qui veut dire qu’on fait discrètement son truc. Je trouve que beaucoup d’Arméniens, qui ne font pas de la résistance politique, font, malgré tout, chacun à leur manière, de la résistance culturelle. Ils maintiennent la notion qu’ils sont Arméniens, ils font vivre les institutions, leurs familles… il y a quelque chose qui se transmet de génération en génération. Ça aussi c’est une résistance. Qu’ils aient peur ou non, ils existent finalement. Ces deux mouvances s’affrontent peut-être sur place, mais se complètent bien aussi.
Connaissez-vous l’Arménie ?
J’ai connu l’Arménie à travers les actions de l’Organisation Terre et Culture qui m’ont surtout fait découvrir l’Arménie rurale. En ce sens, je trouve que je connais bien mieux le pays que si je m’étais cantonné à Erevan. Connaître la capitale, surtout son centre-ville, ce n’est pas vraiment connaître l’Arménie. Le reste est quand même très, très différent.
Avant d’aller en Arménie, quel regard portiez-vous sur ce pays ?
C’était un pays très abstrait pour moi. Dans les années 90 mon père y était allé donc j’avais la notion d’un pays tout petit, assez différent, plein de ressources culturelles et référentielles uniques et qui faisaient qu’aller là-bas c’était autre chose qu’ailleurs. Et les Hayastantsis (les Arméniens d’Arménie, NDLR) qui arrivaient en France donnaient un premier aperçu de ce dont il s’agissait. Après, comme avec la Turquie, il y a toute une série de préjugés que l’on se fait sur Hayastan (l’Arménie en arménien, NDLR). Des préjugés à la fois positifs et négatifs : tout ce qu’on y trouve est la culture authentique/ils sont trop différents ; tout est merveilleux/ce sont tous des escrocs ; on est frères/on ne parle pas la même langue… Il y a aussi tout le discours qui dit que maintenant notre hayrenik (patrie en arménien, NDLR) c’est là-bas, qu’il n’y a rien d’autre, qu’il faut tout miser là-dessus… Il y a tout et n’importe quoi qui se dit sur l’Arménie.
Vous sentez vous proches des Arméniens d’Arménie ?
Ça dépend. Je dirai que oui, je sens que ce sont mes frères et sœurs dans le sens où l’on partage une culture, un passé et j’espère, un futur. On partage un présent autant qu’on peut. Je sens une appartenance, plus qu’avec des non Arméniens. Après, cela veut tout et rien dire. Si l’on reste sur des généralités, je pourrais affirmer que j’ai moins à partager avec un Hayastantsi qu’avec un Aleptsi ou un Beyrouthsi, ou peut-être même moins qu’avec un Parisien de n’importe quelle ethnicité. Mais individuellement, donc en réalité, cela peut s’inverser. Ce n’est pas une question si facile à laquelle répondre.
À propos de votre chanson Notre patrie, qui évoque ces Arméniens de diaspora qui se rendent en Arménie seulement pour faire la fête… Pourquoi une telle chanson ?
Elle a été écrite par Sevana, accordéoniste et chanteuse dans le Collectif Medz Bazar. Il s’agit d’un texte assez frontal, qui ne passe pas par quatre chemins pour dire quelque chose d’assez franc. Dans la chanson on s’adresse à cette masse qui vient en Arménie en été et qui s’en va comme s’il n’y avait rien d’autre à y faire que la fête. C’est quelque chose que l’on peut reconnaitre chez soi-même ou chez nos amis. Il y a une volonté de réveiller les esprits à ce niveau-là. Évidemment, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas comme ça dans la diaspora…
Que souhaitez-vous dire à cette fameuse « masse » ?
Je pense qu’il s’agit de bousculer un peu les idées. On a voulu s’exprimer sur quelque chose qui est perturbant. Nous parlons aussi de notre propre expérience – du moins pour les Arméniens du groupe. Nous ne disons pas : « Nous savons et vous ne savez pas, nous faisons les choses comme il faut et vous non ». Nous faisons un constat et appelons à une réflexion et à l’action !
À la fin de la chanson, vous chantez : « Rébellion, pacifisme, reprise de confiance… ». Qu’est-ce-que cela signifie ?
Il s’agit d’un constat global où l’on parle aussi bien de la diaspora que de l’Arménie. Sans les rattacher directement aux mouvements politiques actuels, nous prenons position en faveur de l’idée de rébellion, d’action, face à une stagnation bien ancrée. C’est un état d’esprit que l’on essaie de défendre, ce ne sont pas des assignations concrètes à rejoindre tel mouvement, à défendre telle ou telle chose.
La chanson Ariur Ar Ariur où vous abordez le thème de l’identité arménienne, est-ce une provocation ou plutôt la volonté de mettre un peu à plat ce que personne ne dit publiquement ?
Provocation, oui, mais pas gratuite. Une provocation pour me soulager, pour nous soulager. Chaque fois qu’on la joue sur scène je trouve une rage en moi qui nourrit ma prestation. Une rage positive, pleine d’humour. Lorsque les gens entendent ça, ça les fait rire, ils reconnaissent ce discours. Tout le monde en diaspora reconnaît ce personnage que j’aime interpréter et qui me fait rire. Son discours a été créé à partir de ce que j’ai entendu autour de moi.
C’est une chanson assez cynique. Pour moi le portrait que je fais n’est pas quelque chose que je veux critiquer, c’est quelque chose dont je veux rire. Je pense qu’on peut en faire une chanson et qu’on peut rigoler de ça. Car tout ce que je dis dans la chanson ce sont souvent des choses sur lesquelles on pleure d’habitude : « Ah, on ne parle plus arménien ; ah, on se marie avec des non Arméniens ; on fait ci, on fait ça… ». Mais si on arrive à rire de ce discours, on le démystifie déjà un peu.
« L’identité arménienne n’est plus que du soudjoukh (saucisse sèche épicée, NDLR) et du pain lavash (pain traditionnel arménien, NDLR) ». Vous le pensez vraiment ?
C’est un constat général très répandu, pas dans ces termes exacts, et qui n’est pas généralisable. Il y a plein d’Arméniens qui ne sont pas que du soudjoukh et du lavash et qui peuvent très vite trouver d’autres repères que ça. À cause de notre histoire c’est souvent un effort de se sentir à l’aise comme Arménien, ce n’est pas quelque chose qui vient comme ça. Quand on n’a pas les moyens de faire cet effort ou quand on n’a pas conscience de ce problème, ça ne se fait pas tout seul. Il y a beaucoup qui se perd et qui est perdu, mais c’est le cas depuis toujours. Personnellement, je trouve énormément de repères autour de moi. J’ai la chance de maîtriser la langue arménienne et c’est quelque chose que je souhaite aux générations futures. Avoir un accès à la langue tel que j’ai pu avoir est un outil d’accès à la culture.
« Il n’y a plus personne qui incarne notre nation ». Que voulez-vous dire par là ?
En gros, cela signifie qu’il n’y a plus de soldats pour cette nation. En fait, il y a une position très généralisée, notamment parmi les voix influentes dans les communautés, qui fait de tous les problèmes évoqués — parler la langue, aller aux manifestations, aller à l’église, se marier avec un Arménien, etc. — l’objet d’un devoir national plutôt que des questions à résoudre de manière plus naturelle, plus positive. Tout ce qui fait enrager mon personnage, c’est tout ce qu’on entend chez ceux qui veulent sauver les Arméniens. Mais le constat final est qu’il est trop tard, qu’on n’arrivera pas à se sauver… C’est l’opposé de ce que je pense moi, mais c’est ce que pense ma caricature.
Qu’est-ce qu’on est devenus aujourd’hui ? / Qu’est-ce qu’on était avant ? Pouvez-vous commenter ces paroles ?
On a tout un héritage que l’on n’arrive plus à assumer. Mais dès lors que l’on dit ça on ferme les yeux sur tout un tas de gens qui vit pleinement sa culture, qui y a accès et qui innove. De plus en plus, je rencontre des Arméniens de ma génération, du monde entier, qui parlent vraiment bien l’arménien— qu’ils soient nés au Moyen Orient ou pas — et qui, à mon avis, vont assurer l’avenir de cette élite intellectuelle de demain dont tant de gens s’inquiètent. On est peut-être, en effet, de moins en moins à se préoccuper ou à faire vivre la culture arménienne, mais en est-on vraiment sûrs ? Il y a tout un discours pessimiste qui, je trouve, ne sert à rien, c’est aussi ça que je tourne en dérision dans la chanson.
Votre discours est vraiment positif quant à l’avenir de la communauté.
Premièrement c’est une réaction à tout ce que je peux entendre autour de moi car, même si c’était vrai que tout va s’écrouler, ça ne sert à rien à le dire. Pourquoi prédire la fin ? La seule chose que cela provoque c’est du découragement, cela désengage les gens et fait que les jeunes qui entendent ça et qui n’ont pas assez de convictions pour pouvoir penser le contraire abandonneront avant même d’avoir essayé. Donc je pense qu’il y a un manque de responsabilité dans ce discours. Beaucoup trop de gens tiennent ce discours.
Finalement, je pense qu’on a du mal avec le changement, à lâcher un petit peu, à faire confiance et à se dire qu’en effet il y a beaucoup qui se perd… En même temps, que voulez-vous qu’on fasse ? Ce qui se perd dans un génocide n’est évidemment pas récupérable. Il y a beaucoup de choses qui auront disparu et c’est ainsi. Mais il ne faut pas cracher sur ce qu’on a encore. Si on regarde vraiment, si on regarde à quel point les Arméniens sont dynamiques dans tant de domaines, il y a de quoi s’accrocher.