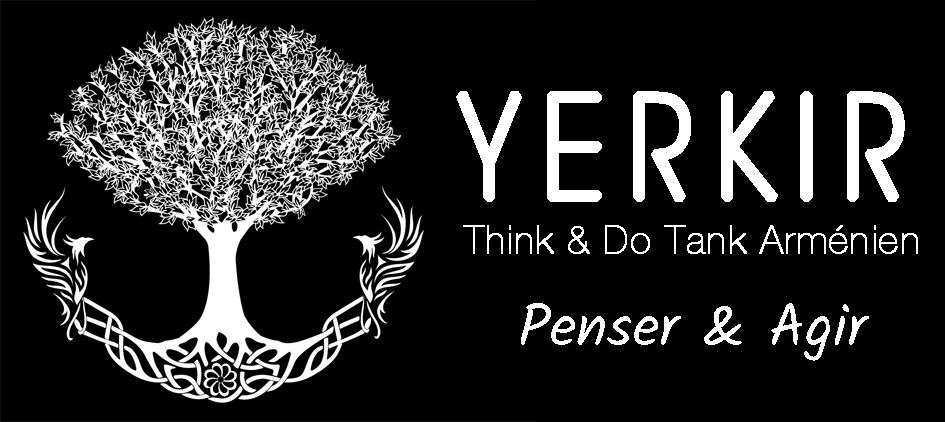Etienne Copeaux
Docteur en géopolitique spécialiste de la Turquie
Ce texte intitulé « L’invention de l’histoire » a été conçu comme un résumé de ma thèse, publié en 1994, dont j’achevais la rédaction et que j’ai soutenue en décembre de la même année. C’est la première fois que j’essayais de transmettre le résultat de mes travaux à un public assez large, celui des éditions Autrement. Il n’y a eu aucun retour, aucune marque d’intérêt. La « thèse d’histoire » des nationalistes turcs était tellement extravagante qu’on a peut-être cru que j’exagérais. D’autres s’étonnaient que je puisse m’intéresser de près à un sujet d’aussi peu d’intérêt. Il faut dire que, parmi les réformes opérées par Mustafa Kemal dans les années vingt et trente, celle-ci était souvent oubliée par les historiens.
Mais cette « invention de l’histoire » n’est pas un sujet annexe de l’histoire du kémalisme. À la suite du génocide des Arméniens, puis du « grand échange » de 1923 (en réalité une double expulsion de masse), la population de l’Anatolie, épuisée et ruinée par onze années de guerres et de violences, était littéralement déboussolée. On parle souvent de ce passage de l’Empire à la république en termes de pertes de territoires, mais il y a bien plus : pour chaque habitant de l’Anatolie ou presque, c’est la perte de la maison, des champs, du jardin, d’un environnement bien-aimé ; la perte d’un voisin, d’un ami, de l’artisan ou du commerçant du coin, l’Arménien, le Grec, désigné comme ennemi, éliminé ou expulsé. Et l’on s’aperçoit, trop tard, que cet Autre faisait partie de soi-même et que sa perte est une amputation.
Il fallait (com)penser la perte. Les kémalistes s’y sont employés en utilisant un récit historique déjà existant, élaboré par les premiers nationalistes, et qui donnait aux Anatoliens une direction, un sens à tout cela, non pas en désignant un futur, mais un nouveau passé, qui allait en principe fixer définitivement une identité turque monolithique et profondément enracinée. Un récit qui rassure.
Mais il est un point sur lequel j’étais trop allusif en 1994, celui du génocide. Je ne le désigne que d’une manière qui ne m’engageait guère : « La question des Arméniens avait été réglée avec la brutalité que l’on sait ». J’étais en train d’étudier le récit historique turc dans son ensemble, son évolution sur plus de six décennies, et j’avais compris, mais pas encore formulé, ce qui me paraît désormais essentiel : ce récit était – et reste – entièrement conditionné par l’existence du génocide. On peut même élargir en disant que toute la vie turque du XXe siècle et au-delà est conditionnée par ce crime originel et sa négation.
Or, qu’est le récit que je présente dans ce texte, sinon un récit-alibi élaboré par des criminels pour masquer leur forfait ? Après avoir effacé les Arméniens, puis les Orthodoxes, de la terre anatolienne, voici que l’Etat effaçait leur histoire et imposait un récit qui devait tout masquer. Toute la politique de « nettoyage ethnique » de l’Anatolie au cours de la première moitié du XXe siècle est dans ce récit, et prouve l’existence du forfait. Car, de même qu’un analyste se fonde sur le récit de son patient pour le comprendre et tenter de le guérir, on pourrait, en utilisant des outils relevant de la psychanalyse, comprendre le non-dit, la négation, le rejet de l’Autre, la construction d’un ego ; mais aussi une culpabilité, un malaise et mal-être destructeurs qui ont sans doute contribué à l’élaboration, ultérieurement, du culte d’Atatürk, le Père qui rassure et protège.
L’historiographie kémaliste et sa genèse
En juillet 1932 se réunissait solennellement, à Ankara, le premier Congrès d’histoire turque, en présence des plus hautes personnalités de la République et de Mustafa Kemal lui-même, qui assista à la presque totalité des débats. S’il est ordinaire qu’un chef d’Etat inaugure un congrès, il n’est pas commun qu’il y assiste pendant toute une semaine, et ce simple fait est révélateur de l’importance qu’on accordait aux questions historiques, en Turquie, aux débuts de la république.
Ce congrès, presque entièrement consacré à la préhistoire et à l’histoire ancienne, illustre le radical changement de perspective apporté à l’historiographie turque.
Jusqu’au début du XXe siècle, un Turc se définissait par son appartenance à l’islam : « Dieu merci, je suis musulman ». Cet élément identitaire était d’autant plus fort à l’époque ottomane que le sultan était en même temps calife, chef religieux de la communauté musulmane. Le caractère multi-ethnique de l’Empire ottoman ne se prêtait de toute façon aucunement à la définition d’une « nationalité » au sens actuel du mot, et le passé n’était pas perçu comme un passé des Turcs, mais comme le passé des Musulmans, c’est-à-dire, grosso modo, le passé des Arabes.
Sous le régime républicain proclamé en 1923, l’enseignement de l’histoire devait s’adapter et répondre à plusieurs nécessités. D’abord, il fallait valoriser la culture turque, dénigrée par les vainqueurs de 1918, et faire naître une fierté turque, mise à mal par l’image désastreuse de la Turquie à l’étranger. Cette image commençait à se redresser pendant les années vingt, grâce justement aux réformes de Kemal, moderniste, républicain, laïc, présenté comme un héritier de la rationalité et du positivisme européens.
Ensuite, puisqu’on qu’on construisait une nation, il n’était plus admissible de continuer à enseigner une histoire étrangère, celle de l’islam ou celle de l’Europe. Il fallait retrouver un passé national, mais lequel ? Les Turcs étaient installés en Anatolie depuis neuf siècles ; ils avaient leur histoire en tant que peuple, et vivaient sur une terre qui avait aussi son histoire. Venant d’Asie centrale, les Turcs avaient épousé l’Anatolie en s’y installant et en s’y stabilisant. Pour que les enfants de ce mariage (les Turcs actuels) soient valeureux, il fallait aussi que la belle-famille le fût. La valorisation du passé asiatique devait donc aussi s’accompagner d’une opération similaire portant sur les anciennes civilisations d’Anatolie qu’on venait de découvrir, Ioniens, Achéens, Ourartéens et surtout Hittites.
La « découverte de l’Asie »
Ce mouvement de redécouverte historiographique est le résultat d’un extraordinaire faisceau de circonstances dans lesquelles le facteur russe est très important.
En premier lieu, la prise par les Russes des khanats d’Asie centrale (notamment celui de Khiva, au sud de la mer d’Aral, en 1873) a provoqué des appels à la solidarité inter-musulmane, adressés, au XIXe siècle, au sultan-calife de Constantinople. Des intellectuels Turcs prennent conscience de l’existence de « frères de race » au nord de la mer Noire et outre-Caspienne. C’est le point de départ du sentiment panturc, dans un sens premier de sentiment d’appartenance non plus à l’umma musulmane, mais à une ethnie dont l’aire ne coïncide pas du tout avec l’Empire ottoman. L’une des premières expressions de ce sentiment paraît la même année à Paris, dans un ouvrage de l’ottoman Ali Suavi, sur la situation du khanat de Khiva.
Toujours en 1873, au premier Congrès international des orientalistes qui se tient à Paris, un écrivain et voyageur, Léon Cahun, présente une communication intitulée Habitat et migrations des races préhistoriques dites touraniennes. Il y présente une carte où figure, au centre de l’Eurasie, une mer intérieure. De grandes flèches qui en divergent représentent les migrations des Touraniens vers la périphérie du continent. C’est l’essentiel de ce qui sera discuté, soixante ans plus tard, au congrès d’Ankara. Léon Cahun, très turcophile, se lie avec les intellectuels ottomans de Paris, grâce auxquels ses idées sur l’histoire turque vont connaître une influence extraordinairement longue : on trouve encore des avatars de cette carte dans les ouvrages scolaires actuels.
En même temps que s’achèvent les conquêtes coloniales, la turcologie russe se développe et donne une impulsion décisive à la prise de conscience de leur passé par les Turcs. C’est l’époque où se constitue un réseau qui transcende les frontières entre l’Empire russe et l’Empire ottoman (essentiellement Kazan, la Crimée et Bakou d’une part, Istanbul de l’autre). Il est constitué d’intellectuels, réfugiés politiques fuyant le régime d’Abdülhamid, ou étudiant à Saint-Pétersbourg, Berlin, Paris. Ils ont fortement intégré les découvertes archéologiques et linguistiques du XIXe siècle concernant l’aire turque, et certains sont eux-mêmes de brillants chercheurs. Ils se sont liés avec des savants russes, finnois, français, allemands… et des chercheurs ou étudiants d’autres régions du monde turc. Des rencontres fructueuses s’opèrent entre ces Jeunes Ottomans et des turcologues souvent turcophiles, parmi lesquels Léon Cahun.
Les stèles de l’Orkhon : La mémoire des Turcs
Il faut connaître ce contexte pour saisir l’importance de la découverte et du déchiffrement de nombreuses inscriptions lapidaires dans la région de l’Orkhon, au sud du lac Baïkal, en Mongolie. En 1893, ces textes sont datés du début du VIIIe siècle et identifiés comme les premiers exemples connus de langue turque écrite ; ce sont des proclamations solennelles, dans une langue littéraire élaborée, de khans turcs à leur peuple, dans lesquelles beaucoup de Turcs, dans leur enthousiasme, ont voulu voir quelque chose comme un sentiment national. Le contexte de l’époque se prêtait à une diffusion et une interprétation rapides du contenu de ces stèles de l’Orkhon, dont on a vite tiré la preuve de l’ancienneté de la langue littéraire des Turcs, de leur organisation en Etat, de leur foi monothéiste et surtout de leur origine centre-asiatique. Les Turcs, brusquement, lors d’une époque cruciale de leur histoire, ont été mis en face de leur passé véritable, de leur personnalité culturelle, de leur originalité, bref, de leur identité propre.
Dès lors les choses vont aller vite : les travaux de Thomsen servent de base à un ouvrage historique de Cahun promptement traduit en turc. La fin du XIXe siècle connaît justement une éclosion historiographique en Turquie et Necib Asim, Süleyman Pacha et le célèbre sociologue Ziya Gökalp sont passionnés par le livre de Cahun. Vers 1910-1914, Gökalp publie de nombreux poèmes inspirés par ce « nouveau passé ».
Les soubresauts politiques russes (1905, 1917) provoquent justement l’arrivée à Istanbul de nouveaux exilés politiques turcophones, généralement des intellectuels tatars ou azéris qui servent de vecteur à la diffusion des connaissances turcologiques russes. Souvent ex-dirigeants des républiques éphémères d’Azerbaïdjan, de Crimée, de Kazan, de Bachkirie, du Turkestan, ils sont empreints d’un esprit moderniste réformateur pour l’islam, et porteurs d’une vigoureuse conscience nationale turque; parmi eux, le Bachkir Sadri Maksudov [Arsal], le Tatar Zeki Velidov [Togan], historiens arrivés dans les années vingt, sont des acteurs des réformes culturelles kémaliennes.
La révolution Jeune-Turque de 1908 a renforcé la conscience turque. L’humiliation de la défaite de 1918 va provoquer, comme en Allemagne, un sursaut de fierté. Quelques années plus tard, après l’extraordinaire sursaut militaire et la fondation de la République, Mustafa Kemal a l’ambition de donner à la Turquie une nouvelle histoire, une histoire turque, et une nouvelle langue, débarrassée des apports arabes et persans. La suppression du califat, la laïcisation de la République entraîne d’ailleurs, comme ce sera le cas plus tard dans les pays arabes de type baathiste puis nassérien, l’adoption d’un discours identitaire national et non plus musulman.
Un processus culturel un peu comparable se déroule en Russie ; peut-être en partie à cause de l’attitude de rejet de l’Europe occidentale, on assiste à un repli sur les valeurs asiatiques: c’est la (re)naissance du mouvement dit « eurasien » qui assume, dans son discours, le poids du passé asiatique dans l’histoire russe. Ce mouvement rejoint d’ailleurs les préoccupations purement historiographiques des décennies précédentes, et l’« eurasisme » tire sa force de la « découverte de l’Asie ». Tous ces mouvements sont donc convergents, mais une rivalité s’instaure entre Bakou et Ankara.
Ankara ou Bakou ?
En janvier 1926, Ayaz Ishaki, un réfugié tatar vivant en Turquie, préconisait une culture commune pour les peuples turco-tatars, la nécessité d’unifier la langue, et « la nécessité de transférer le centre intellectuel du turkisme à Angora, Sivas ou Erzerum ». Mais en mars 1926, l’intérêt pour le passé asiatique se concrétise dans la tenue du premier Congrès de turcologie de Bakou. L’enjeu est de faire de Bakou la capitale intellectuelle du monde turcophone, et la réunion de ce congrès à Bakou est un échec pour les turcologues turcs, et pour les Tatars de Kazan, influents à Istanbul : le centre intellectuel du turkisme se trouve désormais hors d’Anatolie. On débat à Bakou de ce qui sera l’ordre du jour des réformes culturelles kémalistes des années trente. Une exposition est consacrée aux stèles de l’Orkhon. On propose de publier en une langue aisément compréhensible les sources de l’histoire turque ancienne, et Bakou doit devenir un grand centre de turcologie et d’ethnologie, que concrétisera un musée d’études. Certes, les participants portent des toasts à Mustafa Kemal, mais celui-ci s’est fait très nettement devancer par Staline : à Bakou, on met au point un système de transcription de toutes les langues turques. En Turquie, le retour des délégués turcs (Fuat Köprülü et Hüseyinzade Ali) ayant pris part au Congrès est vivement attendu, et l’on pressent que les rapports qu’ils vont présenter auront un poids dans les décisions du gouvernement.
À Bakou règnent une ferveur culturelle turquiste, un enthousiasme de retrouver le passé, une volonté de « retour au peuple » pour retrouver la « vraie » langue turque, toutes choses qu’Ankara vivra de 1928 à 1932 ; les mêmes questions se posent : quel alphabet adopter ? Quelles en seront les conséquences culturelles ? C’est en Azerbaïdjan et non en Turquie que la question de l’alphabet a été soulevée pour la première fois, dès 1863, et à Bakou fonctionne, dès avant le Congrès, un comité pour la propagation de l’alphabet latin. L’alphabet proposé par le congrès est un exemple concret de l’avance de Bakou sur Ankara, qui n’adoptera l’alphabet latin qu’en 1928.
Le kémalisme, ultérieurement, a réussi à faire croire que la Turquie fut la première république musulmane laïque. Mais les intellectuels de Kazan, de Bakou, de Crimée ont été très en avance, et ce sont eux qui ont importé ces idées en Turquie. L’Azerbaïdjan n’était d’ailleurs pas seul dans ce rôle de pionnier : la constitution de l’éphémère république tatare de Crimée (1918) prévoyait l’égalité de suffrages entre hommes et femmes. Le congrès de Bakou est donc une sorte de défi à la Turquie, et l’Etat soviétique est en avance sur le plan du soutien qu’il accorde à la turcologie.
Adam était-il turc ?
Les Turcs de l’époque kémaliste auraient pu prendre simplement le relais des savants occidentaux, faire avancer les recherches et donner à la turcologie une tournure « nationale », ce qui, dans cette période de recherche d’une nouvelle – et réelle – identité, aurait été parfaitement compréhensible. Est-ce le résultat de la rivalité avec Bakou ? Y a-y-il eu surenchère de la part des Turcs ? Les kémalistes n’ont pas su se contenter des résultats et des promesses de l’archéologie et de l’histoire. On assiste dans les années qui suivent le congrès de Bakou d’une part à une organisation étatique de la recherche historique en Turquie, d’autre part, à un regain d’influence des rêveries romantiques de Gökalp, alimentées par les livres de Cahun.
L’historiographie turque ne va plus se contenter d’exploiter les découvertes, le connu (comme les stèles de l’Orkhon). Elle va exploiter habilement l’inconnu, les incertitudes de l’archéologie et de l’histoire. L’origine de certaines civilisations, comme Sumer, les Étrusques, les Crétois, les Hittites qu’on découvre tout juste, pose problème. Plus généralement, on s’explique mal comment s’est faite la « révolution néolithique », les progrès décisifs réalisés par l’homme en Inde, en Mésopotamie, en Egypte et en Europe vers 4000 avant J.-C.
On se passionne, dans les sociétés scientifiques, pour les sujets à la frontière entre géologie et préhistoire, comme le montrent les romans vulgarisateurs de Rosny aîné. A la suite de Léon Cahun, on cherche à reconstituer les contours d’une vaste mer intérieure qui aurait recouvert l’Asie centrale après la dernière glaciation. Divers vulgarisateurs en proposent des cartes, et le célèbre H.G. Wells en fait état dans son Esquisse de l’histoire universelle (1925). Cet ouvrage est traduit en turc dès 1927, par le Ministère de l’Education.
En effet, les turcologues turcs imaginent sur les rives de cette mer une civilisation proto-turque florissante, très en avance sur toutes les autres. Son dessèchement, il y a des millénaires, expliquerait des migrations à très large échelle de ces peuples turcs. Les historiens kémalistes se mettent donc à rêver à une sorte d’Atlantide des sables. L’enthousiasme national porte leurs fantasmes hors des limites du raisonnable. Les idées de Léon Cahun, émises en 1873, vont être réutilisées: les Turcs – de race brachycéphale – sont allés porter leur langue et leur civilisation très loin, jusqu’aux limites du continent. Par ces thèses d’histoire, on pense du même coup résoudre le problème de l’origine des Sumériens, et on croit fournir l’explication des progrès réalisés par les Chinois, les Indiens, les Égyptiens et tous les Européens au néolithique.
Cahun, déjà, croyait apporter à cela des preuves linguistiques. Les Turcs reprennent ses idées et veulent aller plus loin : il faudra donc prouver que les langues turque et indo-européenne font partie d’un tronc commun, et expliquer à partir du turc l’origine de toutes les langues du monde : c’est la théorie de la langue-soleil, formulée au milieu des années trente. Thèses d’histoire et théorie de la langue-soleil mobilisent les intellectuels kémalistes de cette époque ; préhistoire, histoire ancienne, linguistique, anthropologie deviennent les sciences dominantes.
L’explication du monde par une origine turque résout aussi le problème de l’histoire de l’Anatolie, la « belle-famille ». Les Turcs vivent en Anatolie depuis neuf siècles, mais elle était aussi peuplée d’Arméniens et de Grecs. La question des Arméniens avait été réglée avec la brutalité que l’on sait. Mais la Grèce revendiquait des territoires et prit l’initiative d’une occupation militaire de l’ouest en 1919. La victoire militaire de 1922, puis les échanges de populations, ne suffisaient pas à Atatürk ; il fallait, après avoir vaincu, repoussé et expulsé l’ennemi héréditaire, ôter aux Grecs toute assise historique à leurs revendications nationales, prouver que l’Anatolie avait été turque bien avant l’arrivée des Grecs.
Le nationalisme turc va tirer parti de l’archéologie : en 1930, les Hittites commencent à être bien connus (début des fouilles de Bogazköy en 1906). Mais la langue reste encore obscure, et les savants de l’époque ne trouvent aucune correspondance avec les langues anciennes connues. Les linguistes turcs vont s’engouffrer dans cette brèche : il est tentant de proclamer que les Hittites sont des anciens Turcs, justement arrivés d’Asie centrale par migration. Peu importe, après tout, si la linguistique est sur le point de prouver que les Hittites sont des indo-européens, puisqu’en 1936-1937 la théorie de la langue-soleil « prouvera » que toutes les langues procèdent du turc !
En utilisant à la fois les avancées et les points d’ombre du savoir scientifique, les historiens kémalistes forgent un « nouveau passé », répondant à cette nécessité impérieuse pour eux de restituer un passé glorieux aux Turcs – et non plus aux Ottomans. La rupture avec le passé islamique est décidément consommée.