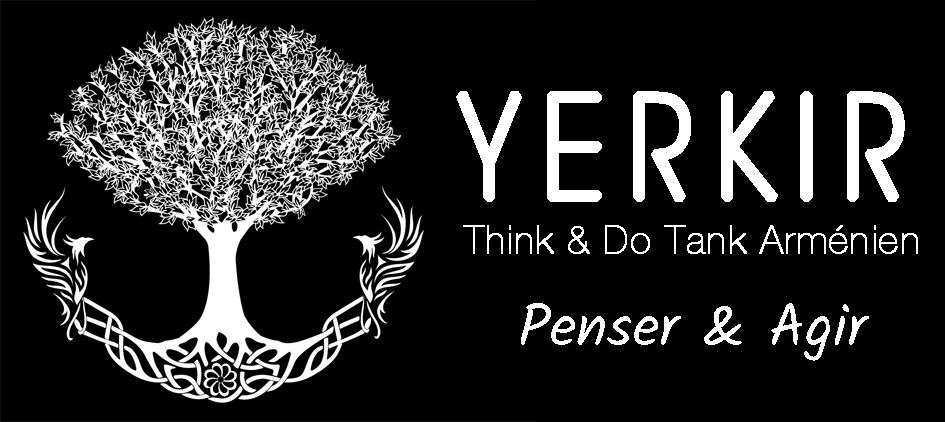Céline Pierre Magnani
Traductrice et journaliste française installée à Istanbul depuis 2008
En déclin constant, le nombre de Grecs de Turquie serait passé de près de 100 000 personnes au début de la République à seulement quelques milliers aujourd’hui. Céline Pierre Magnani évoque dans cet article le rapport très particulier qu’entretiennent les Roums avec la ville d’Istanbul, qu’ils considèrent comme leur véritable patrie. L’auteur aborde également les difficultés auxquelles fait face cette communauté grecque d’Istanbul (la romiosini) dont l’identité s’est considérablement modifiée avec l’arrivée des grecs-orthodoxe arabophones d’Antioche.
L’évocation de « la Ville », en grec i Poli (η Πόλη), nous mène directement à Istanbul… Les hellénophones orthodoxes ont prospéré sur les rives du Bosphore depuis des milliers d’années. Dans l’historiographie grecque, l’Empire byzantin est présenté comme l’apogée de la culture hellène, et la continuité revendiquée par la communauté roum1 (communauté des Grecs d’Istanbul) durant toute la période ottomane a contribué à perpétuer le visage cosmopolite de cette gigantesque agglomération. La naissance de la République en 1923 et la volonté d’affirmation de l’Etat-nation turc ont conduit à définir un statut juridique pour les Roums, dès lors reconnus comme une « minorité »2.
De citoyenneté turque et de nationalité grecque, la romiosini (ρωμιοσύνη, « communauté grecque d’Istanbul ») vit en deux dimensions, partagée entre son espace identitaire référent (la Grèce) et son espace politique concret (la Turquie). Pris dans les cadres classiques de la conception de l’Etat, l’esprit peine à imaginer que nation et territoire ne sont pas toujours superposables. C’est à travers cette double identité qu’il faut essayer de comprendre le rapport des Roums à la ville d’Istanbul.
Officiellement, le consulat de Grèce gère les affaires administratives des ressortissants hellènes à Istanbul. Or, depuis les accords de Lausanne de 1923, les difficultés de gestion entraînées par le statut même de la communauté roum l’ont conduit à intervenir de manière régulière. Comme le patriarcat, le consulat s’est substitué bien des fois à l’institution représentative qui manque à la communauté. Faute d’interlocuteur officiel, le consulat endossait souvent ce rôle. Que le soutien soit politique ou économique, la communauté peut difficilement se passer de cette aide précieuse, bien que les prises de position consulaires ne fassent pas toujours l’unanimité.
Fiers de la spécificité de leur identité, les Grecs d’Istanbul ne se sentent liés au consulat que par nécessité. De nationalité grecque, ils n’en restent pas moins des politis (πολίτης, « habitants de “la Ville” »), des habitants d’Istanbul avant tout. La richesse du vocabulaire employé traduit d’ailleurs la conscience de cette spécificité. Trois termes quotidiennement employés se traduisent par « Grec » en français, et les catégories de pensée de la langue grecque permettent d’introduire une distinction entre culture et origine géographique. Le terme ellinas, (έλληνας) désigne tous ceux qui se sentent dépositaires de cette culture grecque, vivant aussi bien sur le territoire national grec qu’ailleurs. Chypriotes grecs, Grecs d’Istanbul, Grecs de la diaspora… La traduction juste serait plutôt « Hellènes » que « Grecs » si l’imaginaire français, nourri d’études classiques, n’y associait pas une connotation antique.
Istanbul : la véritable « patrie »
Dans le contexte de la communauté d’Istanbul, l’usage du terme elladitis (ελλαδίτης, « Helladique ») est fréquent. Le mot désigne les « Grecs » (ou « Hellènes ») qui habitent sur le territoire national grec afin de les distinguer des Grecs de la communauté. Le terme romios (ρωμιός) est utilisé pour désigner les « Grecs d’Istanbul », c’est-à-dire les Roums. Aussi bien employé en grec qu’en turc (rûm), il désigne donc les « citoyens turcs, orthodoxes de langue grecque » (l’emploi du terme remonte à la période ottomane, les Roums, chrétiens orthodoxes de l’Empire assimilés aux « Romains »). Les Roums sont les garants de la continuité de la romiosini, branche de l’hellénisme épanouie dans le cadre de la ville d’Istanbul. L’existence de cette terminologie spécifique atteste d’une distinction nette dans les esprits. La connaissance parfois approximative du grec et l’accent typique des Roums génèrent parfois un complexe vis-à-vis des « Helladiques ». Ils utilisent d’ailleurs des expressions et un vocabulaire qui trahissent l’influence de la langue turque.
Le territoire concrétise l’identité, lui offre un cadre pour s’épanouir et évoluer. En somme, ils sont en dialogue. Si la société turque reflète l’identité des individus de nationalité turque, qu’en est-il pour un Roum ? L’identité grecque risque de rester abstraite, alors que le dynamisme du quotidien les amène à développer une identité turque vivante. A la question « Quel est ton pays ? », la réponse est toujours la même, i Poli (« la Ville »). Tout se passe comme si leur identité n’avait pas plus de projection possible sur le territoire grec que sur le territoire turc. Espace de synthèse entre nationalité grecque et citoyenneté turque, seule Istanbul est leur véritable « patrie ».
Le patriarcat, les églises, le patrimoine byzantin constituent autant de points de repère dans le paysage de « la Ville » qui confirmaient leurs racines et donc la légitimité de leur présence. C’est d’ailleurs plus sur l’héritage byzantin que sur l’héritage de l’Antiquité que semble se cristalliser la conscience identitaire.
Des mécanismes de protection se mettent en place pour tenter de conserver l’intégrité de la romiosini ; la réticence au mariage mixte (grec-turc) en est un exemple. Nombreuse jusqu’à la naissance de la République turque en 1923, la communauté perpétuait d’elle-même des réflexes « endogames ». Au fur et à mesure des départs, les mariages internes à la communauté se raréfiaient et chaque union mixte signifiait l’érosion de la romiosini. Ce conservatisme est en partie à l’origine de sa continuité historique ; il entraîne souvent le rejet des « nouveautés » apportées par la société environnante, de peur d’édulcorer la culture. La moyenne d’âge avancée de la communauté est symptomatique de ce manque de dynamisme.
Le patriarcat incarne traditionnellement ce pôle conservateur. Son usage du grec comme langue liturgique sous l’Empire ottoman en a fait le garant de la continuité de la nation grecque. Tout au long de la République, le patriarcat a fait l’objet de nombreux soupçons dans l’opinion publique turque. Il est vrai que son statut reste flou : il n’est définitivement plus l’institution religieuse locale qu’avait prévu la République turque et s’internationalise tout en conservant une responsabilité vis-à-vis de la communauté grecque d’Istanbul. Le patriarcat est tour à tour vu comme traître à la République, institution politique locale ou allié de l’Occident. Interface entre la communauté grecque et le gouvernement turc, impliqué dans les relations gréco-turques et acteur de la scène religieuse mondiale, il cumule trois échelles d’intervention.
La nomination en 1991 du patriarche Bartholomée Ier a cependant changé la donne. Réputé pour son ouverture d’esprit, il a permis par son action d’apporter un nouveau souffle à l’institution. L’intérêt manifesté pour des problématiques contemporaines (écologie, dialogue des civilisations…) et les activités de l’institution sous sa houlette ont rehaussé l’image du patriarcat. Avec le consulat, le patriarcat reste référent dans la gestion de la communauté ; il y participe indirectement par simples conseils ou donations. Son rôle religieux auprès de la communauté justifie sa présence à Istanbul ; il est donc directement menacé par la diminution des effectifs. Si ces citoyens turcs orthodoxes venaient à disparaître, le patriarcat d’Istanbul n’aurait plus véritablement de raison d’être. Aller régulièrement à l’église est une manière de consolider les ancrages. D’ailleurs, le rendez-vous dominical relève plus d’un mode de sociabilité que d’une manifestation réelle de la foi : il permet de se retrouver « entre-soi », de prendre des nouvelles, de réactiver les liens communautaires.
De nouveaux questionnements identitaires
Comme pour les églises, la réduction des effectifs freine le bon fonctionnement des établissements scolaires. Les écoles sont le principal vecteur de la transmission de la romiosini, mais elles ferment en nombre, ce qui cristallise les angoisses et pèse sur le moral de la communauté. La Grande Ecole de la nation (1454), Zappeion (1885) et Zografeion (1893) font partie des derniers établissements ouverts, emblèmes d’un âge d’or révolu. Le coût de leur fonctionnement est un gouffre pour le budget communautaire. Pourquoi ne pas concentrer leurs petits effectifs sur un établissement central ? La question ne semble même pas se poser. Bien plus que l’efficacité et l’économie, c’est l’image que la communauté a d’elle-même qui se joue dans le maintien de ces établissements.
La question des écoles soulève un autre problème : l’arrivée des arabophones d’Antioche, qui entraîne de nouveaux questionnements identitaires. La catégorie Rum, utilisée dans l’administration turque, regroupe les citoyens turcs de religion orthodoxe. Or, depuis les années 1990, les vagues de migrations successives ont amené de nombreux orthodoxes arabophones d’Antioche à venir s’installer à Istanbul. Ils sont, au moins administrativement, assimilés à la communauté roum et bénéficient, au regard de la loi, des mêmes prérogatives que les individus de nationalité grecque. Dans le cas des écoles, leur arrivée pose un problème tout particulier, celui de la langue. En tant que Roums, ils fréquentent les établissements scolaires de la communauté, mais sont mécaniquement pénalisés faute de connaître le grec. Si les enfants scolarisés dès le plus jeune âge peuvent rapidement s’en imprégner, les plus âgés rencontrent de sérieuses difficultés pour jongler entre la langue arabe d’origine, le turc imposé et le grec, désormais nouvelle langue d’étude.
Leur nombre a augmenté de manière constante ces dernières années et ces élèves représentent désormais jusqu’à 50 % des effectifs dans certaines classes. La question du niveau des étudiants se pose, mais elle est secondaire. La véritable préoccupation de la communauté, c’est celle de l’assimilation à la romiosini. Les réactions sont variées ; elles vont du rejet pur et simple à la volonté d’intégration. La dynamique démographique des arabophones est inverse de celle des Roums. Gonflant les effectifs, ces arrivées permettent de maintenir ouverts des établissements scolaires anciennement menacés. Ce dynamisme permet aussi d’anticiper un inversement du rapport de force à long terme. Faut-il continuer à faire vivre la romiosini si le contenu de sa définition doit changer ? Les Roums de l’administration turque seront demain majoritairement arabophones, tandis que la romiosini hellène est amenée à s’éteindre.
La question des départs fait partie des sujets tabous dans ce petit monde où tout le monde se connaît, s’observe et se jauge à l’aune de sa fidélité à la romiosini d’origine. Au regard des chiffres, la situation de la communauté laisse peu d’espoir de se renouveler. Mais quelques personnalités très actives se battent pour le maintien de cette romiosini et les représentations semblent se transmettre efficacement. En Grèce comme en Turquie, l’origine de l’autre occupe une place essentielle dans les perceptions. On expose ses origines remontant jusqu’à la deuxième, troisième génération ; on parle avec fierté du grand-père qui venait de « la Ville ». Plus que le lieu de provenance, c’est l’atmosphère culturelle de l’autre qui intéresse. Une romiosini d’ici et d’ailleurs prend forme : de nombreux Grecs d’Istanbul partis s’installer à l’étranger perpétuent le lien à la communauté d’origine. Et pour eux, le maintien de la romiosini constitue un enjeu vital, comme si l’existence des descendants de la communauté ne pouvait avoir de sens sans un référentiel vivant de la culture d’origine.
1. En turc, le terme « Rum » (« οιρωμιοί » en grec) désigne les individus appartenant à la communauté orthodoxe de langue grecque établie sur le territoire de la Turquie actuelle. Dans le langage courant, il est également utilisé pour désigner les Grecs chypriotes. La catégorie administrative « rum orthodoxe » qui lui est associée inclue également les orthodoxes arabophones d’Antioche (Hatay). Depuis la conférence de Lausanne (1922-1923), la communauté roum bénéficie du statut officiel de « minorité », à l’instar des communautés juives et arméniennes.
2. La communauté des Grecs de Turquie s’est régulièrement réduite depuis 1923. Evaluée à près de 100 000 personnes au début de la République[2], elle ne compterait plus que quelques milliers d’individus à Istanbul (1500, selon les chiffres avancés par le Patriarcat d’Istanbul) dont une majorité aurait plus de 60 ans. Tout au long du XXe siècle, les départs se sont faits à destination de la Grèce, ainsi que vers les pays traditionnels de la diaspora grecque (pays d’Europe occidentale, Etats-Unis, Australie, Canada …). De facto en décalage avec les politiques d’homogénéisation culturelle, la « romiosini »(« ηρωμιοσύνη ») a évolué sous pression, prise en tenaille entre les logiques de deux Etats nations. Plusieurs étapes historiques semblent avoir accéléré le processus d’émigration : 1942 « varlık vergisi » ou impôt sur la fortune ;les évènements du 6 et 7 Septembre 1955, dits « pogroms » dirigés contre la minorité grecque; 1963-1964 puis 1974 lors de la crise chypriote.