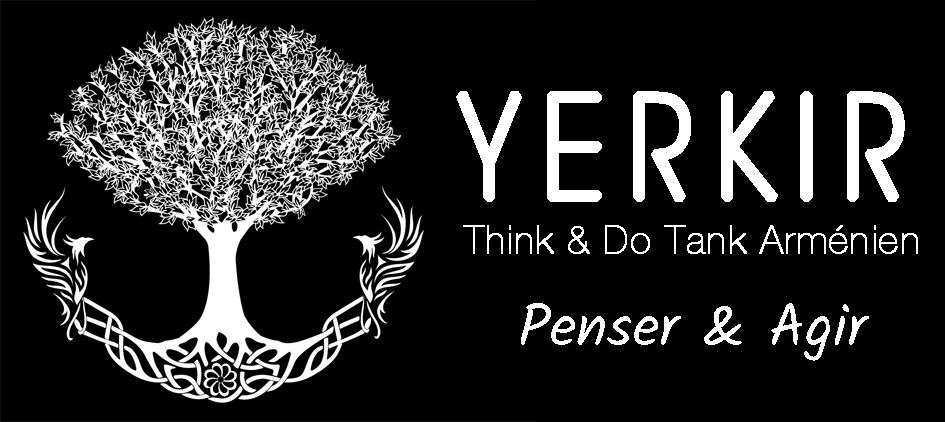Arménie-Turquie, la nécessaire distinction entre réconciliation et normalisation des relations
Rouben Shougarian
Ancien diplomate d’Arménie, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University
Dans cette version réduite d’une interview parue sur le site panorama.am le 28 décembre 2016, Rouben Shougarian explique tout d’abord pourquoi il est nécessaire de départager clairement deux domaines distincts qui sont la réconciliation et la normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie. Selon lui, « quand les deux processus de normalisation et de réconciliation sont entremêlés on se retrouve dans une impasse ». L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères d’Arménie ― auteur d’une thèse ayant pour titre : L’Histoire contemporaine et la méthodologie de la médiation internationale des relations arméno-turques ― analyse également la politique étrangère arménienne et la diplomatie de l’Arménie et de la République du Haut-Karabakh. Il constate notamment, évoquant les relations avec les États-Unis, que « dans la politique extérieure [de l’Arménie, ndlr], les intérêts de la nation l’emportent sur l’intérêt de l’État ». Enfin, l’ancien ambassadeur de l’Arménie aux États-Unis conclut en déclarant que l’Arménie a besoin d’une politique étrangère indépendante – ce qui impliquerait, selon lui, la résolution du problème du Karabakh et la normalisation arméno-turque.
Monsieur Shougarian, vous venez de soutenir votre thèse de doctorat à l’Institut d’études orientales de l’Académie nationale des sciences d’Arménie. Votre travail a pour titre « l’Histoire contemporaine et la méthodologie de la médiation internationale des relations arméno-turques ». Qu’est-ce qui vous a fait choisir ce thème ?
J’y ai songé pendant de longues années. Aussi bien à l’époque où j’étais impliqué activement dans la diplomatie, en tant que participant aux négociations de normalisation des relations avec la Turquie et du règlement du conflit du Haut Karabakh que pendant les années de travail académique, surtout lorsque j’enseignais à l’école de droit et de la diplomatie Fletcher de l’Université Tufts aux USA.
Ce thème est parmi les sujets d’actualité. Je connais plusieurs études à ce sujet, pourtant il semble qu’il n’existe pas un travail systématisé en la matière s’attachant non seulement à l’aspect historique, mais également qui porterait une réflexion sur la méthodologie du travail effectué par les médiateurs pendant les 25 dernières années. Mon but fut de combler cette lacune, tout en proposant une certaine « feuille de route » pour l’avenir.
Quelles sont les idées nouvelles que vous apportez ?
En termes de nouveautés, je propose de départager clairement deux domaines distincts qui sont la réconciliation et la normalisation des relations. J’hésitais en ce qui concerne le choix du titre de mon travail : fallait-il parler de relations Arménie-Turquie ou de relations arméno-turques ? Finalement j’ai conclu que lorsqu’on parle des relations Arménie-Turquie, il faudrait évoquer aussi bien la réconciliation que la normalisation, se concentrant peut-être davantage sur l’aspect de la normalisation. Or, tout ce que ce format suppose, c’est l’ouverture de la frontière et l’établissement de relations diplomatiques et rien d’autre. Les participants naturels à ce format sont les deux gouvernements des pays concernés. Alors que l’aspect de la réconciliation suppose un processus de plus longue haleine qui est en même temps plus discret et complexe, incluant au-delà des autorités, les sociétés civiles des pays respectifs, ainsi que, dans le cas de l’Arménie, la Diaspora arménienne dont la voix doit être décisive. À mon sens, jusqu’à présent, la principale erreur a été la fusion de ces deux processus, ce qui non seulement n’est pas justifié, mais aussi comporte des risques surtout en ce qui concerne la critique de la Diaspora.
Il faut noter, que malgré l’échec du processus, toutes les parties impliquées ont atteint un certain succès. La Turquie a pu montrer au monde sa capacité d’être « constructive », surtout à la veille du centenaire du Génocide, pour dire qu’ils n’ont pas d’idées préconçues et qu’ils pourraient sans contrainte confronter leur histoire par le biais de cette sous-commission d’historiens.
L’Arménie, elle, avait besoin de faire un retour dans la politique internationale, de figurer sur la carte internationale. Et nous l’avons fait. Il suffit de se souvenir de la cérémonie de signature (à Zurich). Tout cela était nécessaire à l’Arménie.
Pendant la décennie précédente la politique « complémentaire » avait aidé à éviter de grands bouleversements, mais à cause de celle-ci nous avions perdu, d’une certaine manière, du rythme, de l’influence et peut-être aussi, de l’importance [dans la politique internationale]. Lorsqu’un pays commence à caractériser sa politique extérieure d’un seul mot, cela signifie son contraire. Ainsi, la politique turque de « zéro problème avec les voisins » signifiait qu’Ankara avait en réalité des problèmes avec tous ses voisins. Si nous parlons de la politique extérieure « d’initiative », cela veut dire que « le complémentarisme » n’a pas fait preuve d’initiative.
Par la diplomatie du « football » nous avons résolu le problème de notre retour en politique internationale, en même temps que celui de la légitimité extérieure, après l’élection de 2008. Nous avons pu obtenir des résultats à court terme.
La Russie a résolu ses propres problèmes. Pour la première fois non seulement le Kremlin ne s’opposait pas à l’agenda arméno-turc, mais également il le soutenait activement. Primo, parce qu’après la guerre russo-géorgienne de 2008, Moscou avait besoin de redorer son blason et secundo, c’est qu’à l’issue de cette guerre, la Russie et la Turquie avaient conclu qu’il fallait renforcer leurs propres positions dans la région, réduisant autant que faire se peut l’influence des pays tiers. Dans cette optique et sur fond d’affaiblissement du rôle de la Géorgie perçue comme « annexe » des États-Unis elles avaient ouvert la possibilité d’une augmentation du rôle de l’Arménie.
L’Union Européenne aussi est sortie gagnante à l’issue du processus de Zurich étant donné qu’en cas de ratification de ces protocoles, la question de l’adhésion de la Turquie serait beaucoup plus réelle. Aussi, la solution « signé, mais non ratifié » était-elle la meilleure pour l’UE.
En ce qui concerne l’Iran, je dois dire qu’on peut juger des questions régionales une fois qu’on a étudié la position de Téhéran. Ainsi, lors des négociations de Key West de 2001, l’Iran affichait une attitude tout à fait sereine parce qu’il n’y prévoyait aucun résultat tangible. La même chose ici : il semble que l’Iran était persuadé que les Protocoles seraient signés, mais non ratifiés.
Dès le départ, la Géorgie était inquiète de la perspective de l’éventuelle normalisation, puisqu’à la suite de celle-ci le rôle de Tbilissi allait s’amoindrir considérablement.
Les États-Unis avaient besoin de trouver une quelconque solution transitoire permettant aux relations arméno-turques de franchir une nouvelle étape, ce qui n’obligerait pas la Maison-Blanche à chercher, chaque année, à l’occasion du 24 Avril, de nouveaux synonymes au terme « génocide » et s’en justifier ensuite auprès de la communauté arménienne. Le deuxième objectif de Washington était, après les échecs de l’administration Bush, de pouvoir enregistrer une quelconque réussite politique extérieure. Ce n’est pas un hasard si le président Barak Obama et la secrétaire d’État Hillary Clinton aient effectué leurs premiers déplacements vers la Turquie où le coup d’envoi du processus a été donné.
À l’issue de ce processus, presque tous les pays ont pu enregistrer des succès. Le seul pays n’ayant pas besoin d’améliorer son image était l’Azerbaïdjan dont le seul souci était de se faire considérer comme un pays « fort et influent » afin de faire croire que c’est à cause de l’Azerbaïdjan que la Turquie n’arrive pas à avancer dans ce dossier de normalisation.
Souvent, lorsque nous évoquons le processus arméno-turc de Zurich, les spécialistes se rapportent à la position de Bakou, en tant que pays exerçant une influence considérable sur la Turquie, ce qui aurait pu avoir un effet décisif sur l’échec du processus. Ne sommes-nous pas à confondre ici la tête et la queue d’un même corps ?
Je pense que vous avez raison. Si vous voulez, c’est la transposition orientale du procédé occidental « bon policier- mauvais policier ». Mais ce qui importe de comprendre ici, c’est : quelle est l’erreur méthodologique des médiateurs en la matière ?
Avez-vous étudié également les possibilités de la diplomatie informelle, de la société civile, en termes de normalisation des relations arméno-turques ?
Oui, j’ai étudié non seulement le processus de négociations officielles, mais aussi les possibilités et l’expérience accumulée de la plateforme pour ainsi dire « médiane » ou plateforme 1.5 et celles de la plateforme 2 (Track Two) ou diplomatie populaire. J’ai étudié, par exemple, les travaux de la commission de réconciliation arméno-turque et leur lien avec le processus de Zurich. Par ailleurs, j’ai présenté le processus palestino-israélien d’Oslo, ayant assisté à la signature du texte, à la Maison-Blanche, en septembre 1993, en qualité d’ambassadeur d’Arménie aux États-Unis.
Il y a aussi certains faits historiques ou propositions apparus pour la première fois, tels que les offres canadiennes ou italiennes de médiation dans la normalisation arméno-turque.
Dans votre ouvrage, vous dites que la Suisse a entrepris cette mission de médiation et vous notez par ailleurs que l’établissement de relations sans conditions préalables en était le fil conducteur pour les trois présidents arméniens. Vues d’outre-Atlantique, pourquoi, à votre avis, les négociations sont-elles devenues un thème de combat virulent entre les différents pôles politiques en Arménie ?
L’une des principales raisons selon moi est qu’à chaque fois, les processus de réconciliation et de normalisation ont été présentés comme un seul, tant par les médiateurs que par l’Arménie. La partie arménienne n’a pas combattu jusqu’au bout cette confusion. Si nous nous penchons sur la médiation suisse pour comprendre le rôle de la Diaspora, nous devons nous rappeler le périple du président Serge Sargsyan auprès des communautés arméniennes de la Diaspora, chose qu’il faudrait saluer. Mais, dans le cas où la question de réconciliation est sur le tapis, il faudrait, comme je l’ai signalé, que la voix de la Diaspora soit décisive. Tandis que si nous parlons de la normalisation, nous n’avons même pas besoin de nous déplacer (en Diaspora) pour en recevoir les critiques. Mais le président avait fait ce voyage en raison du point sur « la sous-commission d’historiens » figurant dans ces textes. La question suivante est, bien entendu, celle concernant la frontière, mais à ce propos nous devons chercher à mener un travail explicatif approprié. Quand les deux processus de normalisation et de réconciliation sont entremêlés on se retrouve dans une impasse.
Le problème de l’Artsakh et les relations avec la Turquie ou, plutôt, leur absence, sont les deux points majeurs de l’agenda de la politique étrangère de l’Arménie. Quelles sont selon vous les questions que la politique étrangère arménienne pourrait exploiter l’année prochaine et au-delà ?
Je suis profondément persuadé que la politique étrangère arménienne ne peut être réduite à ces deux questions (je pense maintenant qu’on ne peut pas régler l’une sans l’autre).
Après l’indépendance nous avons montré plus d’une fois que nous pouvions nous occuper d’autres questions aussi. Nous avons envoyé des forces de maintien de la paix en Bosnie, en Irak et en Afghanistan. À ce propos, dans le cas de l’Irak nous avons assisté à des développements intéressants qui méritent d’être réévalués.
Lorsque nous étions en train de discuter de l’envoi d’un contingent, d’autres pays se retiraient au contraire de la coalition des alliés américains, entre autres, l’Espagne. À cette époque-là, beaucoup de lettres arrivaient en provenance de différents centres de la Diaspora arménienne, appelant à renoncer à cet engagement. Néanmoins, nous avons intégré les forces de la coalition en Irak, marquant des points dans nos relations avec les États-Unis, etc. À cet égard nous avons pu faire ce qui était dicté par l’intérêt de « l’État », améliorant nos relations avec les États-Unis dans différents domaines, tandis que les intérêts de la « nation » demandaient autre chose.
Pendant les dernières années, je constate que dans la politique extérieure, les intérêts de la « nation » l’emportent sur l’intérêt de « l’État », alors que dans différentes langues européennes, une telle distinction n’existe même pas dans la notion de « national interest ». Un autre pays où cette distinction existe est peut-être Israël.
Quant à l’agenda de l’année prochaine, je pense que nous devons être très actifs dans la question syrienne, nous devons être plus visibles et prendre part à diverses initiatives diplomatiques. Je pense que, passé un certain temps, nous devons avoir une participation dans les relations arabo-israéliennes, privilégiant particulièrement le rôle et le facteur du quartier arménien de Jérusalem. Dans les années 1990, l’Arménie a effectué aussi certaines missions de médiation qu’on a oubliées aujourd’hui, telles que plusieurs fois en Géorgie ou en Lituanie, en 1991, etc.
Comment caractériseriez-vous la diplomatie de l’Arménie et de la République du Haut-Karabakh pendant les journées d’avril et après ?
Pour la diplomatie de la République du Haut-Karabakh je dirais qu’elle était conforme à la situation de l’époque. Non seulement l’Artsakh a pu tenir tête sur le champ de bataille, mais aussi adopter une tactique pertinente sur le front diplomatique. On pourrait citer par exemple l’interview du ministre des Affaires étrangères de la RHK Karen Mirzoyan à CNN où il apparaissait en présence de son homologue azéri E. Mamediarov, ce qui montrait une nouvelle fois s’il en faut, les deux protagonistes du conflit.
Il m’est un peu plus difficile de parler de la diplomatie arménienne. S’il existe un arrangement interne selon lequel le Karabakh doit être plus actif et se présenter en partie au conflit, je pense que c’est une position juste. Mais dans tous les cas je pense que non seulement la diplomatie arménienne doit être plus active, mais aussi qu’elle pense à mettre en place de nouvelles formes, de nouveaux sujets, de nouvelles idées et qu’elle pose de nouvelles questions.
Je pense qu’après la guerre d’avril la question la plus importante n’était pas : « qu’est-ce qui s’est passé ? », mais : « comment cela est-il arrivé ? »
Avant avril 2016, l’Azerbaïdjan se dirigeait lentement vers l’escalade de la situation. Dans les nouvelles conditions géopolitiques on pourrait qualifier les actes de l’Azerbaïdjan de crimes de guerre, si l’on considère les atrocités qu’ils ont fait subir aux prisonniers et aux personnes civiles. Bakou ne cherchait même pas à dissimuler les objectifs de sa politique d’État et de l’agression militaire contre la RHK.
L’Arménie doit chercher à présenter et faire comprendre au monde que le président Aliev durcit sa position de jour en jour. Je mettrais en avant trois étapes pour montrer la continuité de cette politique. Tout d’abord, en 2011, Aliev a fait part de son intention de bombarder les avions civils à destination de l’aéroport reconstruit de Stépanakert. Il s’agit d’une déclaration sans précédent. Deuxièmement, le transfert de Safarov à Bakou, suivi de sa décoration des plus hautes distinctions nationales, à la suite de négociations avec la Hongrie. Et troisièmement, la guerre d’avril. Ces événements, à première vue n’ayant aucun lien direct entre eux, doivent faire partie d’un même dossier à présenter à diverses instances européennes ou ONG internationales en vue de faire appliquer au Karabakh la norme de la « sécession pour le salut » (remedial secession). Je rappelle ici que cette norme avait été appliquée au profit du Kosovo.
Si j’utilisais des termes imagés, je dirais que le maintien de la sécurité de l’Artsakh avec l’aide de l’Arménie et la victoire militaire, dans les années 1990, fut le « prix » que nous avons payé à la place de la reconnaissance internationale de la RHK par la communauté internationale. C’est par nos propres forces que nous avons pu protéger le peuple de l’Artsakh du danger de génocide. Ainsi la communauté internationale n’avait plus à intervenir de quelque manière que ce soit, et l’indépendance de l’Artsakh ne fut pas reconnue.
Est-ce qu’à propos du problème de la RHK la diplomatie arménienne prend en considération quel pays est l’Azerbaïdjan ? Je veux dire : la diplomatie arménienne considère-t-elle l’Azerbaïdjan comme un pays qui souhaite réellement régler le conflit ou qui l’instrumentalise afin d’assurer, dans la politique interne, l’inviolabilité de ses élites ?
À mon avis, Ilham Aliev est un politique qui n’a pas l’envergure d’un homme d’État, aussi votre question est tout à fait fondée.
Récemment est paru votre troisième livre qui porte un titre extrêmement intéressant et provocateur « Est-ce que l’Arménie a besoin d’une politique extérieure ? » (« Does Armenia Need Foreign Policy ? », Gomidas Institute, 2016). Dans cet ouvrage vous posez plusieurs questions, essayant, dans l’ensemble, de présenter les défis et les potentialités de la politique étrangère arménienne au travers du processus arméno-turc de Zurich, évoquant en même temps les relations de l’Arménie avec la Russie, les États-Unis et l’UE et vous parlez des causes de l’échec de l’accord d’Association et de l’adhésion à l’Union économique eurasiatique. Finalement vous laissez au lecteur le soin de trouver la réponse à la question du titre. Je voudrais vous demander : de « quelle » politique étrangère l’Arménie a-t-elle besoin ?
L’Arménie a besoin d’une politique étrangère indépendante. Pour que cette politique soit « indépendante », il faudra avoir résolu le problème du Karabakh et la normalisation arméno-turque ou bien, il faudra que l’un de ces deux processus ait enregistré une avancée considérable.
Mais ceci ne veut nullement dire que nous devons avoir, ce que j’appelle en anglais, une « foreign policy wish-list », qui ne signifie pas «foreign policy wishful thinking », une sorte de pensée romanesque. Ce sont des choses différentes. Nous devons penser quelle sera notre politique étrangère si ces deux problèmes sont résolus. Dans nos relations avec la Russie, un pays dont l’importance pour nous est très grande, nous devons arriver à une véritable alliance « stratégique ». Ces relations pourraient être mutuellement avantageuses et efficaces, si nous passons du statut de « frère cadet » à de véritables relations stratégiques. Dans ce cas, la Russie sera intéressée elle-même pour que l’Arménie ait une politique étrangère indépendante.