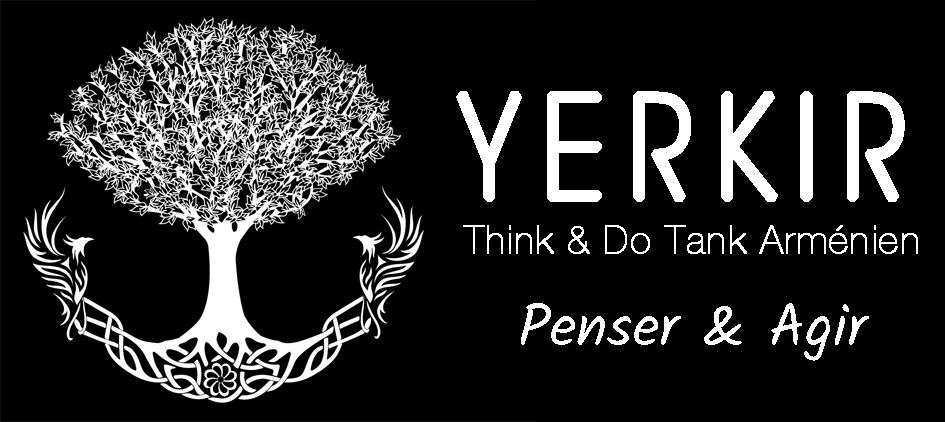Reconnaissance du Génocide Arménien, point de vue d’une psychanalyste
Hélène Piralian
Psychanalyste
Si l’on veut comprendre la nécessité impérative de la reconnaissance du génocide des Arméniens, malgré le temps qui nous en sépare et qui semble l’éloigner, il faut prendre en compte ses spécificités et les effets psychiques qui en découlent. Et ceci, aussi bien pour les descendants des Arméniens que des Turcs dont les destins sont liés.
Si la principale caractéristique du projet génocidaire est celle de vouloir, au-delà du meurtre des membres d’un groupe, de faire disparaître le groupe lui-même en faisant disparaître tous ses membres — non seulement du présent mais aussi du passé donc du futur — cela dit clairement que ce projet a pour objectif le meurtre, et au-delà du meurtre des vivants, de leurs descendants. C’est cela que son déni maintient actif au présent et c’est aussi pourquoi il est imprescriptible.
Or, si le destin d’un disparu est tragique puisqu’il ne peut être, pour ses proches, ni vivant ni mort et que son deuil reste ainsi suspendu, plus encore est celui du disparu dont la disparition est programmée et organisée et s’accompagne, au-delà du déni, de l’effacement de cette disparition, c’est-à-dire de l’existence même du disparu comme dans un génocide. C’est alors que ce disparu devient plus qu’un disparu, un « n’ayant jamais existé »[1], ce qui prive ses descendants non seulement de son deuil mais aussi d’antécédence puisque « l’ayant existé » même du disparu est dénié.
D’où sans doute l’obsession, l’acharnement des rescapés à vouloir témoigner et la hantise de la mort du dernier témoin vivant qui signifierait alors le risque de la disparition, de la chute dans le néant de tout le groupe ; comme si tant que quelqu’un pouvait encore témoigner de cette volonté d’effacement elle était tenue en échec.
Face à cela, il semblerait qu’il ne resterait plus aux survivants pour retenir hors du néant et empêcher que ne disparaissent définitivement ces disparus que d’offrir leurs corps comme sépultures à ceux que, dès lors, tout concourt à exclure de l’ordre humain. Quant aux héritiers de ces survivants ils seraient doublement pris dans cette impossibilité de vie propre puisqu’ils se devraient d’être fidèles, non seulement aux disparus mais aussi à ces survivants qui les ont précédés et qui furent les premiers porteurs de ce deuil impossible. Se met ainsi en marche une destruction génocidaire qui, si rien ne vient l’arrêter, se poursuit de génération en génération. Il s’agirait alors ici plutôt que d’une transmission, d’un transfert à la génération suivante d’une impossible transmission ou de celle de son échec.
C’est pourquoi je poserai la question de la transmission ainsi : comment restaurer, après un génocide, une transmission qui permette une vie autre que la survie aux survivants et à leurs héritiers, autre que celle consistant à présentifier les disparus pour les empêcher de disparaître, en faisant corps avec eux et en incarnant leur douleur ?
Car maintenir au présent la catastrophe, l’incarner, est une manière de se donner en preuve de ce qu’elle a bien eu lieu, mais rend, en contrepartie, pour cet héritier-là, toute vie propre, toute sortie du lieu du meurtre génocidaire et de la douleur qui l’accompagne impossible voire interdite. Puisque ne pas ou ne plus tenir en visibilité la disparition rendrait ce survivant ou cet héritier complice de la disparition même.
D’où cette question : comment sortir de ce lieu qui n’est que celui de la survivance et où la vie n’est vécue que pour maintenir en visibilité le meurtre d’un autre ?
Question qui pourrait aussi être reformulée ainsi : comment les survivants et leurs héritiers peuvent-ils sortir les disparus « génocidés » hors du néant, les réinscrire dans leur statut d’ayant été vivants pour ensuite les inscrire comme des ancêtres morts, c’est-à-dire les réinscrire dans une transmission générationnelle, sans les abandonner au néant ?
Il faut, en premier lieu, pour cela que les survivants et leurs héritiers puissent penser que sortir du génocidaire n’est ni une trahison ni un abandon. C’est pour cela qu’il est impératif que l’existence du génocide, son « ayant eu lieu », soit reconnue et inscrite dans l’histoire de la Turquie. C’est là que la demande de reconnaissance par les gouvernements tiers prend tout son sens. Tout aussi importante est la pénalisation de son déni puisque celui-ci maintient actif le meurtre génocidaire sur les descendants actuels de ce génocide en rendant impossible toute sépulture réelle ou symbolique. Absence qui entraîne la nécessité pour ces survivants et leurs héritiers d’incarner au présent en même temps que les disparus, le génocide lui-même.
Un autre point me paraît important comme étape du deuil c’est celui de la réincarnation, de la ré-individualisation des disparus, lesquels ne seraient plus dilués dans une masse anonyme mais redevenus des sujets singuliers ; c’est-à-dire après qu’on ait restitué à chacun d’eux son individualité, autrement dit les spécificités qui constituaient son identité dans l’avant de sa disparition.[2]
Ainsi et encore une fois, tant que les disparus, les siens, forment masse avec tous les autres disparus inconnus, les identifications des survivants ne peuvent se faire qu’à un disparu abstrait et impersonnel en même temps qu’à un corps incorporé de douleur indépassable et non guérissable, dirons-nous.
Dès lors, la subjectivation du survivant ne peut que rester en suspens, prise dans les raies de la mort et de la douleur de ce corps devenu atemporel et immortel. C’est ainsi qu’il se trouve chargé d’une dette monstrueuse et non remboursable, piège d’une humanité à soutenir à tout prix et qu’il occupe, en cela, une position éthique extrême.
La subjectivité du survivant, c’est-à-dire ce qui lui appartiendrait en propre, ne peut donc redevenir possible qu’à partir de la restitution de celle des disparus et lui donnerait accès à la possibilité à la fois de s’en différencier et de s’en séparer. Le survivant pouvant alors, en s’appuyant sur les éléments constitutifs retrouvés des disparus, y nouer ses signifiants propres, qui, à ce moment-là peuvent émerger en lien avec ceux des « retrouvés ». Alors que jusque-là ils étaient comme « interdits de séjour » puisqu’ils menaçaient à la fois les disparus de disparition définitive et eux-mêmes d’engloutissement dans le néant.
Sortir de la survivance, en ce cas, ce serait donc bien pouvoir réinstaller les disparus comme des vivants puis des morts, ce qui permettrait à leurs enfants de ne plus être à leur tour des survivants porteurs d’un deuil impossible mais simplement les héritiers d’autres humains. Le génocide pourrait alors interrompre sa répétition atemporelle et, quittant en quelque sorte le présent, appartenir à un passé révolu.
Retrouvailles et pertes seraient, dans ce cas, concomitantes. Les disparus n’étant retrouvés que comme perdus, retrouvés pour pouvoir être (devoir être) perdus parce que devenus enfin des ancêtres comme les autres.
Ce processus que je viens de décrire existe pour tous les Arméniens — qu’ils soient d’Arménie, de la diaspora, de Turquie ou crypto-arméniens — mais aussi pour les Turcs qui en prennent de plus en plus conscience et surtout l’expriment publiquement.
C’est ce qu’exprime ainsi Fethiye Çetin dans Le livre de ma grand-mère : « ce que je venais de découvrir ne correspondait pas du tout à ce que je savais. Tout le savoir que j’avais jusque-là se retrouvait sens dessus dessous, mes valeurs étaient ébranlées, mon cerveau lancinait de douleur et de confusion, j’avais peur que ma tête n’explose et que son contenu n’éclabousse tout autour de moi. » [3] Dans ce livre, elle raconte comment sa grand-mère lui apprend qu’elle est arménienne et ce qu’elle a vu et vécu pendant le génocide. Fethiye Çetin se révèle ainsi être arméno-turque et descendante d’une crypto arménienne.
Face à cela, il semblerait que pour toutes ces personnes, prises bien que différemment, dans le processus d’effacement de ce génocide, sa reconnaissance, qui rendrait possible la réapparition puis le deuil des disparus, serait un acte fondateur d’une réparation. Celle ci permettrait, au-delà du présent, que le futur, l’avenir des générations des uns et des autres, des Arméniens et des Turcs, se réinscrive enfin dans une histoire commune vivante.
Il y a donc urgence à ce que les héritiers de ce génocide, chacun de sa place, s’intéressent de près aux autres pour mettre fin aux mensonges et que chacun puisse, dès lors, rejoindre ses origines, parfois composites et à partir de là, reconstruire son identité à la fois dans la différence et le partage avec les autres.
[1] Pour plus de développement voir Hélène Piralian, Génocide et transmission et Génocide disparition, déni, éd. de l’Harmattan
[2] Daniel Mendelsohn dit, dans son livre Les disparus dans lequel il nous raconte sa recherche des personnes de sa famille rescapés de la Shoah : « J’étais à la recherche de la mauvaise histoire, l’histoire de la façon dont ils étaient morts, plutôt que celle dont ils avaient vécu. […] L’histoire réelle, c’était le fait qu’ils avaient été des gens ordinaires, qu’ils avaient vécus et qu’ils étaient morts comme tant d’autres.»
[3] Fethiye Çetin, Le livre de ma grand-mère, éd. L’aube.