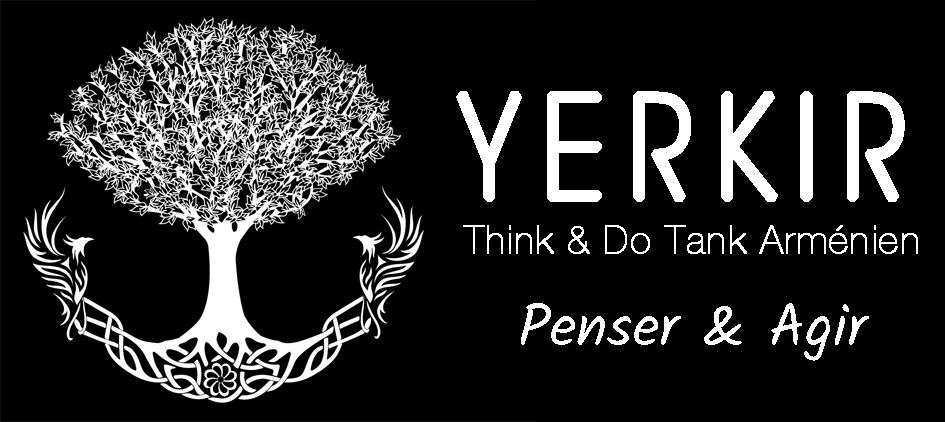Serge Avedikian
Comédien et réalisateur français
Comédien et réalisateur français, Serge Avedikian est un des premiers artistes de la diaspora arménienne à défendre la nécessité de parler avec les Turcs. Il constate aujourd’hui que le processus de dialogue est en stagnation et que le résultat des différentes initiatives reste mitigé. Pour en sortir, le réalisateur compte sur une parole neuve venant d’une nouvelle génération d’intellectuels et d’artistes turcs.
Comment avez-vous rencontré Hrant Dink ?
Notre première rencontre a eu lieu dans les bureaux d’Agos. Quand j’étais de passage à Istanbul, en 1998, pour me rendre dans un festival à Bodrum, un premier article sur moi était paru dans Agos. Mais on s’était raté avec Hrant car il n’était pas en ville. Quand je suis revenu en 2003 à l’occasion du festival de Boursa et pour les repérages de Nous avons bu la même eau, j’ai été convié à donner une interview. Je me rappelle très bien de ses premiers mots. Il m’a dit en arménien, en se levant et en me prenant dans ses bras : “Tu étais devenu un mythe pour moi, mais là, tu es une réalité”. Ça m’a évidemment un peu secoué, je me suis dit : “Mais qu’est-ce qu’il pense de moi pour dire ça ?”. Je lui ai donné une interview à propos du festival de Boursa et surtout de la redécouverte de Sölöz (Ndlr. le village du grand-père de Serge Avedikian situé près de Boursa et où il a tourné le documentaire, Nous avons bu la même eau) pour la deuxième fois en treize ans. Il était très étonné, ce qui m’a surpris car avec tout le savoir qu’il avait sur la communauté arménienne et son histoire, il ne connaissait pas Sölöz. Ce qui veut dire que bien des histoires ont eu lieu, pas si loin que cela d’Istanbul, que les Arméniens eux-mêmes ne connaissent pas. Ce qui est normal, tout cela était caché. Et il a poursuivi : « C’est incroyable l’histoire de ce village. Il faut que tu m’en parles plus ». Notre lien a continué. Je l’ai rencontré avant d’aller en tournage à Sölöz, après le tournage et quand le film a été monté. Une fois, on est allé au restaurant avec Hrant, Cengiz Aktar, Ali Bayramoglu et Taner Akçam, de passage à Istanbul, qu’il m’a présentés.
Vous avez connu ces intellectuels d’Istanbul par le biais de Hrant Dink ?
Exactement. Parce qu’à Istanbul, à part quelques personnes d’origine arménienne, je ne connaissais pas grand monde dans les milieux cinématographiques ou intellectuels. C’est lui qui m’a fait connaître lors d’une soirée au restaurant « Chez Boncuk » au premier étage, comme il se doit, toutes ces personnes qui l’entouraient.
Vous avez visionné avec Hrant Dink, à Istanbul, une des premières versions de Nous avons bu la même eau ?
Oui, c’était six mois avant sa mort. J’étais venu à Istanbul au festival du cinéma du court métrage. Pendant ce temps-là, on avait monté une première version du film. Valérie Terranova, une des conseillères de Jacques Chirac, était de passage et m’avait demandé de lui présenter Hrant. Comme je voulais lui montrer un premier montage du film, pour faire d’une pierre deux coups, on a fait cette projection. C’était très émouvant. D’ailleurs les liens sont particuliers puisque c’est Valérie Terranova qui m’a appelé pour m’annoncer la mort de Hrant.
Hrant Dink avait dit : « Mais c’est ce film qu’il faut montrer en diaspora. Il montre qu’il faut aller en Turquie et parler avec les gens ».
Là où on était complètement en phase avec Hrant, c’était sur la nécessité de montrer une ouverture d’esprit et une capacité d’aller vers la Turquie d’aujourd’hui, toutes tendances confondues – sauf les fascistes – de parler aux gens, leur dire qu’on était là et d’autre part, le besoin de partager notre propre découverte, le chemin qui était en train de se faire en diaspora sur la Turquie. C’est exactement le travail que Hrant faisait avec Agos, avec les articles sur les villages en Anatolie, sur les auteurs arméniens, sur la vie avant le Génocide. Et sur l’ignorance de la Turquie après le Génocide. Nous avons bu la même eau faisait aussi ce travail, c’est-à-dire aller à la rencontre d’un village, des citoyens turcs qui ignoraient eux-mêmes, en partie, l’histoire de ce village. C’est vrai que symboliquement c’était très fort, que ce soit des Pomaques qui occupent l’espace qu’avaient occupé les Arméniens, qui racontent ce qu’ils avaient ressenti en tant qu’immigré eux-mêmes dans cette histoire d’échange de populations et qui portent un regard sur ce que les Arméniens avaient construit et laissé comme trace. Ça a été un des points forts pour nouer un dialogue un peu différent. Je pense que Hrant était non seulement solidaire de cela, mais il était en plein, à sa façon, avec son équipe, dans ce travail. Il y a eu une vrai rencontre entre le travail que Hrant faisait avec Agos et notre travail.
C’était une époque où la plupart des Arméniens de la diaspora n’imaginaient même pas venir en Turquie ou parler avec les Turcs.
En tout cas, ceux qui le faisaient, le faisaient un peu en cachette. Ils venaient par exemple chercher un souvenir. A Sölöz, on a appris que des Arméniens étaient passés récupérer un objet ou une pierre tombale. Mais tout cela se faisait en cachette parce que c’était un tabou. Je pense qu’on a dans cette démarche cassé ce tabou. Alors qu’il n’y a pas de reconnaissance de son histoire, comment un Arménien pouvait-il aujourd’hui dialoguer avec des Turcs, en Turquie-même, sur le lieu précis où il y avait eu des déportations et le Génocide. Ce tabou est tombé avec le film et avec le travail que faisait Hrant.
Il y a eu beaucoup de critiques envers le film à cause de cela.
Il y a eu une frange de la diaspora française très sceptique, qui disait : « Mais tu te fais avoir, tu ne peux pas dialoguer avec des gens qui ne reconnaissent rien ». Je pense que c’était une période de transition pour beaucoup, notamment les jeunes.
On peut dire qu’après ce film et plusieurs autres projets, des Arméniens de la diaspora ont commencé à venir en Turquie. D’une certaine manière, vous avez ouvert la voie, qu’est-ce que ce processus a changé, à la fois chez les Arméniens et les Turcs ?
Les gens ont commencé tout d’abord à réellement parler, à poser de vraies questions. Comment faire pour sortir de l’impasse du non dialogue ? Comment faire pour sortir des tabous de part et d’autre ? En fait, les deux parties sont coincées par leurs extrêmes. Côté turc, pour le gouvernement et les nationalistes, c’est : « Comment pouvez-vous dialoguer avec des Arméniens qui vous obligent à reconnaître un génocide qui n’existe pas ». Et côté arménien : « Comment pouvez-vous parler avec des gens qui ne reconnaissent même pas que c’est un Génocide. C’est un dialogue de sourds ». Je pense que c’est ce barrage qui a été forcé, mais pas pour tout le monde. A mon sens, le résultat est un peu mitigé. Il ne faut pas oublier que lorsque l’appel à la signature de la demande de pardon a été lancé par des intellectuels turcs – qui a fait aussi tomber des tabous – le résultat escompté n’a pas été aussi brillant que le pensaient les organisateurs. Ils imaginaient un raz de marée, l’espéraient en tout cas, et moi aussi avec eux. Cela aurait pu donner lieu à une prise de parole démocratique de ceux qui, jusqu’à maintenant, se taisaient. Ils pensaient qu’il y aurait un million de signatures. Je crois que ça n’a pas dépassé 30 000, ce qui est déjà pas mal, mais c’est quand même très loin des espérances. Je dirai que ce processus a ouvert une brèche, a permis à beaucoup de jeunes de faire des voyages en Anatolie… Il y en avait eu auparavant, mais cette fois-ci de façon ouverte. Il y a eu des rapprochements et des débats avec des intellectuels turcs comme Ali Bayramoglu, Cengiz Aktar, Ahmet Insel et Taner Akçam, en particulier en France. J’ai assisté à presque tous. Il y a eu aussi des livres de dialogues entre Arméniens et Turcs. J’ai l’impression que cette période s’est un peu calmée, car maintenant il y a des initiatives à plus long terme, un peu plus pérennisées et approfondies qui vont naître de ce mouvement. Des films aussi, j’en suis sûr. Quand on est pionnier malgré soi, on voit venir les choses car on prend la température. Ça ne va peut-être pas se faire tout de suite. Il y a des temps d’inertie, des scepticismes qui reviennent. Il ne faut pas oublier qu’il y a eu la mort de Hrant, qui a été à double tranchant.
Quand ces initiatives ont commencé à se multiplier, Hrant Dink devenait dangereux en Turquie. A votre avis, qu’est-ce qui le rendait si dangereux ?
Je pense que c’est son audace et sa prise de parole franche. Tant qu’un intellectuel reste démonstratif intellectuellement, il n’est pas dangereux. Il ne devient dangereux que quand il arrête d’être intellectuel, quand il mène une vraie bataille avec des mots ressentis, avec des mots que tout le monde peut entendre et qui peuvent être entendus par beaucoup. Je pense que c’est à ce moment que les autorités ont senti que cet homme était gênant. Il prenait trop de place, et surtout avec son charisme il entraînait des intellectuels turcs. Au lieu d’être devant lui, ils étaient derrière lui. Je pense que c’est ça qui a fait très mal dans cet assassinat. Car encore une fois, c’est un Arménien qu’on a tué et non pas un opposant turc, ce qui a changé beaucoup de choses et soulevé une grande partie de la population qui l’écoutait. Des centaines de milliers de personnes étaient dans la rue à son enterrement.
Est-ce que vous vous attendiez à une telle réaction en Turquie ?
Non. Je pensais que ce serait solennel et récupéré par le gouvernement, ce qui a été d’ailleurs en partie le cas, mais je ne pensais pas qu’il y aurait autant de monde dans la rue. Personne n’avait prévu une telle levée de boucliers de la part des gens avec leurs pancartes. Cette manifestation ne s’oubliera jamais, elle se perpétue, de façon moindre, mais quand même importante, à chaque anniversaire, elle est devenue une sorte de symbole. D’un autre côté, il n’est plus là. Il n’y a plus de meneur. Ça s’est atomisé aussi. Chacun reste dans son coin, de façon désordonnée. Il y a la fondation, il y a des initiatives et tout cela est relativement positif, mais il n’empêche que c’est une bataille qui a été amputée de sa tête.
Il faut peut-être trouver cette fois-ci une « tête » parmi les intellectuels turcs ?
Absolument. A la tête d’un mouvement réellement contestataire, pour une démocratie plus grande, pour la reconnaissance d’un certain nombre de choses en Turquie, il faut que ce ne soit pas un Arménien. Hrant était un citoyen turc, mais il faut un citoyen à qui on ne puisse pas reprocher d’être un « sperme d’Arménien » ou de Kurde. C’est aussi ce qui est difficile en Turquie parce que tout de suite on est accusé, des réflexes d’antan et des ostracismes reviennent, alors que si c’est un Turc, ce sera autant de moins en tous cas.
Il y aura une autre signification aussi.
Oui. Cela voudra dire une maturation de la société civile en Turquie, qui ose se dévoiler. Elle existe, sans aucun doute parmi les journalistes, les intellectuels, les artistes. J’en suis convaincu. Osman Kavala, fait à sa façon et en tant qu’entrepreneur dans le domaine culturel, des choses immenses et incroyables. Et il continuera à le faire. Il en faut d’autres.
Six ans plus tard, comment voyez-vous la situation générale et politique en Turquie ? Est-ce que la prise de conscience sur ces sujets a avancé ?
Je pense qu’il ne peut y avoir de recul. Mais il y a des temps d’arrêt, de maturation, de compréhension et de digestion. Je pense aussi que le temps d’élaboration de la réplique à donner est en train de se faire. Sous quelles formes elle va apparaître ? J’en connais quelques unes, mais pas toutes. Les artistes vont s’exprimer dans les mois à venir. Il y a une nouvelle génération d’intellectuels, plus jeunes, mûrs, qui ne sont pas des professeurs d’université, des journalistes ou des vedettes reconnues, et qui ont les mains un peu plus libres. Parce que moi aussi j’ai un certain âge, je sais ce que ça veut dire de jouer avec sa renommée, d’avoir peur de perdre sa place. Il y a une autocensure. Il faut des gens qui ne font pas d’autocensure parce qu’ils n’ont rien à perdre. C’est pour cela que je mets en place un nouveau projet où je souhaite donner la parole à de tout jeunes cinéastes, dans des pays très différents, pour parler de l’idée de la diaspora par exemple.
Vous étiez assez critique à un moment donné concernant le fait que le processus de dialogue en Turquie n’avançait pas vraiment. Qu’est-ce que vous en pensez aujourd’hui ?
C’est facile de critiquer ou de constater. Mais il faut surtout essayer de comprendre les raisons, en particulier les raisons souterraines. Quand des grandes choses naissent, il faut un certain temps pour les digérer et trouver un nouveau langage, parce que se répéter ad vitam aeternam lasse les gens et n’apporte pas grand-chose. C’est pour cela que j’ai parlé de nouvelles générations. Ceux qui actuellement s’expriment ont plus de 50 ans. Ils ont vécu des périodes charnières, d’ouverture, d’assassinat et autres, très importantes politiquement. Mais aujourd’hui, la nouvelle génération perçoit cela à sa façon. Evidemment, ces intellectuels doivent continuer à s’exprimer. Mais je pense que leur rôle véritable, ce que je me donne comme rôle aussi, c’est de passer le flambeau. C’est d’inciter les jeunes, c’est-à-dire ceux qui ont entre 25 et 35 ans, avec une vraie conscience et qui étudient les choses, d’accéder à une nouvelle parole. Il faut que les intellectuels arrêtent de monopoliser l’espace. Nous, on n’arrête pas de répéter les mêmes choses. La découverte vient d’une parole neuve, innocente. Cette stagnation doit conduire à plus de réflexion. Il faut inciter les gens à écrire et à prendre la parole sur des sujets plus profonds.
l’approche de 2015, quelle tendance va le plus peser : celle des milliers de personnes qui commémorent six ans plus tard Hrant Dink ou celle des manifestations où on porte des pancartes : « Vous êtes tous Arméniens, vous êtes tous des bâtards » ? Quel est votre sentiment ?
Je sens que ça va être important. Mais j’ai un peu peur que ce soit une bataille de façade et qu’on perde la réflexion en profondeur. La placardisation d’une cause révèle aussi certaines choses à des gens qui n’entendent rien. Mais là où la bataille risque d’être intéressante, c’est lorsque ces jeunes réalisateurs turcs de Turquie ou d’Allemagne révéleront leur film de fiction ou de documentaire à la face du monde. C’est cette parole qui va faire la différence. Et pas celle des Arméniens. C’est celle d’une Turquie dans le sens global du terme, c’est-à-dire des gens qui se disent Turcs mais qui vivent ici et là, qui vont révéler leur positionnement vis-à-vis de cette histoire de façon plus forte que d’habitude. Ça peut être de la peinture, du cinéma, de la littérature, un essai politique ou philosophique, ou une forme de prise de parole politique. Il y a beaucoup de projets en Arménie et en diaspora, mais ce n’est pas cela qui sera intéressant. Ce qui serait inattendu, c’est le film d’un jeune réalisateur turc reconnu, ou l’ouvrage d’un jeune écrivain, et dans les deux cas quelqu’un qui vit à Istanbul. C’est ça qui fera la différence. Peut être aussi des manifestations un peu différentes en Turquie que celles du 24-Avril. Avec un vrai positionnement, des colloques… Ça a déjà eu lieu, il ne faut pas l’oublier. Mais il faut que ce soit de façon plus visible et par le plus grand nombre.
Un des rêves de Hrant Dink était de voir des artistes arméniens et turcs chanter ensemble sur la même scène. Est-ce que ce rêve se réalisera si on a l’occasion de voir l’opéra Anouch sur lequel vous travaillez à Istanbul ?
Ce sera un des éléments. Anouch est un projet rêvé pour montrer certaines choses. Il est écrit par un Arménien à la base comme poème, un compositeur arménien qui est entre Erevan, Tbilissi, Alexandropole et Istanbul, et il a déjà été joué en turc. Je n’ai pas encore mis la main sur le texte en turc, mais je suis sûr qu’on y arrivera. C’est un projet rêvé pour dire : ça a eu lieu avant le Génocide, ça a eu lieu après le Génocide et ça a lieu maintenant et de façon ouverte pour tout le monde. C’est un type qui n’habite plus ni à Erevan ni à Istanbul, mais habite à Paris, qui a pris l’initiative d’un renouveau, d’un dépoussiérage d’une œuvre populaire, qui parle absolument à tout le monde. Ça parle à la Turquie aussi bien qu’à l’Arménie. L’opéra Anouch relate des histoires de crimes d’honneur qui pourraient se passer en Anatolie ou dans le Caucase et qui se déroulent dans des montagnes qui ne portent pas de nom. Je souhaiterais très vivement qu’en 2014, Anouch arrive à Istanbul et dans d’autres villes, par exemple à Diyarbékir. Ça parlera aussi aux Kurdes. Il sera présenté fin avril à Erevan. J’espère qu’ensuite on pourra le programmer à Istanbul et ailleurs.
Istanbul est maintenant dans presque tous vos projets ?
Absolument. Le film sur Paradjanov est presque prêt et on sera à Istanbul au printemps ou à l’automne prochain, pour des festivals. Paradjanov va aussi faire parler de lui à Istanbul. C’est un type qui a fait un film en arménien sur un Géorgien, un Azéri, en pleine guerre azéro-arménienne. Les artistes doivent être transfrontaliers, doivent dépasser les clivages. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème, mais ces œuvres pointent les problèmes. Le film sur Paradjanov sera aussi politique, même si c’est à travers l’art, le cinéma et le collage. L‘opéra Anouch le sera à sa façon. Et pour Le Dernier round à Istanbul, j’espère qu’on sera prêt en 2015. Donc 2013, 2014 et 2015 vont porter trois gros projets toujours vers Istanbul. De toute façon, c’est un des lieux de ma naissance spirituelle. Mon grand-père est né à quelques kilomètres d’Istanbul, c’est par Istanbul que son bateau est reparti vers l’Arménie, et c’est par Istanbul qu’on est revenu. Istanbul est au centre.