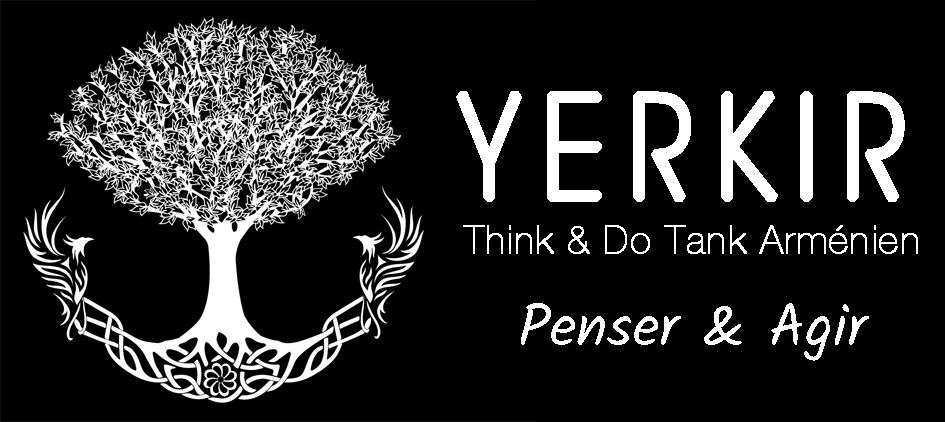Ayda Erbal
Département de Politique, Université de New York
Cet article analyse la responsabilité des universitaires dans un domaine d’études où des groupements d’intérêt, non seulement turcs mais du monde des affaires et du gouvernement américains, se sont agressivement employés à maintenir de façon systématique et institutionnalisée un dogme académique fait de contrevérités et demi-vérités, d’omissions, de passages sous silence, d’obscurantisme et de déni. Les ravages n’ont pas tant affecté le champ même des études sur le génocide – où de nombreux spécialistes ont pu démystifier le credo du discours négationniste – que celui des études ottomanes et turques. Dans ce champ d’études historiquement aveugle aux génocides finaux de l’Empire ottoman, le négationnisme s’est normalisé et formalisé en un discours construit, devenant ainsi une source d’ambiguïté morale diffuse parmi les universitaires, avec ou sans leur pleine connaissance des enjeux ou leur approbation des stratégies de réduction au silence.
Au début de sa critique de l’ouvrage de Donald Bloxham, The Great Game of Genocide [Oxford Universty Press, 2007], le regretté Donald Quartaert faisait prudemment et en termes très mesurés un état des lieux des études ottomanes au terme de sa carrière. Entre les lignes, il évoquait les structures de pouvoir ancrées dans ce domaine – surtout en Amérique du nord, où les gardiens du temple excellaient dans l’art de gouverner sans en donner l’impression – un domaine parfaitement étatisé.
À la fin des années 1960 (quand j’ai commencé mes études supérieures), il y avait un gros sujet tabou au milieu des études turques et ottomanes : le massacre des Arméniens ottomans en 1915. Ce sujet a continué d’être tabou pendant très longtemps. Pourtant, autant que je sache, personne n’a jamais suggéré que la « question arménienne », comme on l’appelait, ne soit pas étudiée. Disons plutôt qu’une lourde atmosphère d’autocensure pesait sur l’écriture de l’Histoire ottomane. Mais d’autres sujets aussi divers que les identités religieuses, les Kurdes ou l’histoire du travail étaient aussi hors limites. Les Arméniens n’étaient pas les seuls à subir l’évitement ou l’oblitération académique, ni les seules victimes de violence et de discrimination approuvées par l’État dans l’Empire ottoman.
Vingt-et-un ans après avoir signé avec 68 autres universitaires (dont une majorité sans rapport avec l’étude génocide) la tristement célèbre lettre ouverte publiée en page publicitaire dans le New York Times et le Washington Post pour contrer la Résolution 192 soumise au Congrès des Etats-Unis en 1985, où ils exposaient leurs réserves quant au terme « génocide » appliqué à la Turquie et l’anéantissement des Arméniens, Donald Quataert s’exprimait sur le sujet. Et il en paya le prix, forcé de quitter son poste de Président du Conseil d’administration de l’Institute for Turkish Studies (ITS). Les membres du Conseil Marcy Patton, Kemal Sılay, Resat Kasaba et Birol Yesilada démissionnèrent par solidarité et Fatma Müge Göçek annonça qu’elle démissionnerait. Le Comité pour la liberté académique (Committee for Academic Freedom ou CAF) de l’Association des Études moyen-orientales (Middle East Studies Association ou MESA) intervint également à travers l’envoi d’une lettre de protestation au Premier ministre turc Erdogan et à d’autres personnalités. Ces trois actions ne s’élevaient toutefois pas contre la négation normalisée du Génocide arménien qui imprégnait ce domaine universitaire à l’époque mais contre la violation de la liberté académique de Quataert. Universitaires et étudiants diplômés pouvaient continuer à fermer les yeux sur le tabou au beau milieu de leur champ d’études sans voir de répercussion morale, éthique ou politique. Dans le contexte du Génocide arménien, le discours négationniste est presque toujours considéré comme un moindre mal au regard du racisme ouvert, en dépit du fait que certains fondements du négationnisme – que ce soit la déshumanisation, la brutalité, l’indifférence, la minoration de l’étendue du crime et/ou de l’asymétrie du pouvoir, le refus d’accorder une légitimité à des sources jugées subalternes ou de prendre en compte le rôle historique au péché originel de la nation par le racisme institutionnel et d’élite dans la Turquie contemporaine – sont issus de la boîte à outils du racisme. Contrairement aux travaux sur la l’Holocauste juif, il a été et demeure acceptable de nier le Génocide arménien puisque ceux qui défendent ces vues ne sont pas sanctionnés.
Comme souvent, les gardiens du dogme sont aussi ceux qui ont écrit l’Histoire : les historiens du domaine Heath Lowry et Howard Reed, étaient aussi les rédacteurs (Lowry) et signataires (tous deux) de la lettre de 1985. De même que ce domaine d’études s’est construit sur l’approbation tacite de la négation du Génocide arménien, sa propre histoire impliquait aussi le déni de la négation et toutes les servitudes intellectuelles attachées. De leurs récits respectifs du développement des études ottomanes et turques aux États-Unis, celui de Lowry est le plus révélateur pour qui sait lire entre les lignes et comprendre ses omissions. Sans diminuer les mérites descriptifs des travaux de Lowry et Reed, ils sont tout à fait incomplets sans le descriptif méticuleux par Speros Vryonis de la collusion entre l’ITS et les intérêts commerciaux turcs et américains ainsi que de la relation de cause à effet entre le développement du domaine et les priorités de la politique étrangère américaine vis-à-vis de la son alliée de l’Otan, la Turquie. Ils ne se comprennent pas non plus sans lire l’article de Roger W. Smith, Eric Markusen et Robert Jay Lifton sur l’affaire Heath Lowry (le scandale universitaire déclenché quand l’ambassadeur turc Nüzhet Kandemir a envoyé par mégarde à Lifton un mémorandum et une lettre rédigés par Heath Lowry pour sa propre signature, preuve supplémentaire de la collusion de l’ITS et ses chercheurs avec les intérêts de l’État turc). Le fait que cet article soit publié dans un organe d’études sur l’Holocauste et les génocides plutôt que d’études moyen-orientales est aussi parlant en soi.
Ma propre thèse traite d’un des principaux agents d’une dynamique négationniste en constante adaptation : l’intelligentsia établie de Turquie. J’affirme que, maintenant comme jadis, le maintien de la négation du Génocide a été entretenu non seulement par les historiens officiels de l’État mais également par les universitaires des Études ottomanes et turques de façon collective à l’intérieur et hors de la Turquie. De la fin des années 1950 jusqu’au début des années 2000 s’est perpétué une solidarité normative entre l’État et des acteurs de la société civile, un pacte du silence qui cachait l’étendue des crimes raciaux périodiques des ères ottomane et républicaine – citons les attaques contre les Juifs en Thrace dans les années 1930, le Génocide du Dersim, la déportation kurde de la fin des années 1930, incluant celle des « restes de l’épée » (les Arméniens survivants), l’Impôt sur les biens des Minorités, les Conscriptions des Vingt Classes de soldats arméniens, grecs et juifs, le pogrom d’Istanbul des 6-7 septembre 1955, la déportation des Grecs de 1964, les massacres de Corum, Maraş et Şivas et le déplacement interne forcé des Kurdes dû à la guerre turco-kurde des trente dernières années. Les contradicteurs de cet ordre établi en ont forcé les portes non de l’intérieur mais de l’extérieur. Vahakn Dadrian, Taner Akçam, Raymond Kevorkian et Donald Bloxham, pour n’en citer que quelques uns, ne sont pas des historiens ottomanistes. Il y a quelques exceptions à cette règle, la plupart en Europe, tels que Hans Lukas Kieser et Erik Jan Zürcher, indirectement. Une indication de l’attitude timorée de la plupart des historiens ottomanistes traditionnels est visible dans le quatrième tome de la prestigieuse Cambridge History of Modern Turkey, dans laquelle certaines de ces questions « controversées » sont enfin mentionnées mais seulement de façon minimaliste voire très problématique. Par exemple, les massacres arméniens (et non pas, bien sûr, le « Génocide arménien ») ne sont mentionnés qu’en passant dans un court paragraphe de Sükrü Hanioglu, en tant que « l’un des événements les plus tragiques de la guerre ». Hasan Kayalı, quant à lui, ne consacre également pas plus de quelques lignes aux assassinats de Mehmet Talaat, Ismail Enver et Amhed Djemal. Les « allégations arméniennes de génocide » et « parfois turques », dont traitées dans une note de bas de page par Kemal Kirisçi et à nouveau très brièvement par Hamit Bozarslan dans le corps de son chapitre. Les cas des Syriaques et des Grecs byzantins ne sont même pas mentionnés.
Au vu de l’étude d’ensemble que j’ai conduite pour ma thèse à la fois sur les discours académiques et populaires, je peux affirmer que les acteurs de la société civile actifs dans la construction du discours sur le génocide arménien, tout au moins dans les quinze dernières années, ont mis en œuvre une rhétorique plus sophistiquée de négation du génocide que la plupart des élites au service de l’État en Turquie et au-dehors. Cette rhétorique est portée par un double langage développé de la façon suivante : en niant ou feignant d’ignorer l’asymétrie de pouvoir entre eux-mêmes et leurs interlocuteurs à la fois en Turquie et dans les diasporas ; en dominant les intellectuels arméniens éparpillés tout en jouissant eux-mêmes des bénéfices d’un espace intellectuel national et d’une langue uniques ; en exerçant leur privilège de groupe majoritaire agissant en propriétaires du champ d’études, catégorisant les Arméniens en catégories typiquement racistes de bons (citoyens arméniens de Turquie), mauvais (Arméniens de la Diaspora, politiquement militants) et pauvres (citoyens d’Arménie) ou en les instrumentalisant lors de leurs propres conflits politiques soit avec le Adaletve Kalkınma Partisi (Parti Justice et Développement) ou Cumhuriyet Halk Partisi (Parti républicain du Peuple), selon leur position dans le spectre politique. Je critique aussi la littérature universitaire opposant État et société civile, qui ne prend pas suffisamment en compte la colonisation intérieure, les capacités d’extirpation et de redistribution ethno-religieuses de l’État d’après le nettoyage ethnique et par conséquent son ancrage et sa perpétuation à travers l’éducation et une société civile pratiquant l’exclusion et la ségrégation ethniques. Aucune théorie libérale ou marxiste de l’État ne peut saisir cette fonction ethno-religieuse constitutive d’un tel État colonisateur de son espace intérieur. J’analyse aussi trois cas récents de rencontres entre des intellectuels libéraux ou de gauche turcs et des Arméniens, montrant d’une part l’imprégnation d’un déni sophistiqué du génocide et d’autre part le manque complet d’analyse de la dimension raciale des rencontres contemporaines entre intellectuels majoritaires et minoritaires d’une part, et intellectuels majoritaires et membres des diasporas d’autre part.
À l’occasion du centenaire du Génocide arménien et presque une décennie après l’aveu de Quataert, Eric Jan Zürcher a posté sur la page facebook du Département d’Etudes turques de l’Université de Leiden une déclaration bientôt reprise sur le blog de Research Turkey et traduite en turc. Zürcher présentait d’abord une vue d’ensemble du passé récent des études turques puis, méthodiquement, revenait sur certains des changements que lui-même avait traversés pendant ses études, surtout en ce qui concerne ses pensées sur l’histoire de la Turquie et son approche théorique. Il argumentait avec précision le fait que la persistance du négationnisme était une option à la fois éthiquement intenable et inopérante pour fonder une analyse historique légitime. Au-delà, la négation du génocide est un problème débordant largement du seul cadre arménien/turc, ayant été entretenue pendant toutes ces années pour des raisons politiques et stratégiques concernant la région tout entière. En outre, la controverse Quataert de l’Institute of Turkish Studies, puis la lettre MESA-CAF en défense du professeur Keith David Watenpaugh, et le manque de recherches sur ces problématiques montrent clairement une chose :que les chercheurs internationaux en Études turques ne sont prêts à affronter la négation de l’État turc qu’en cas d’atteinte radicale à la liberté d’expression de l’un des leurs.
Un autre facteur que Zürcher ne prend pas en compte est l’existence de deux mondes académiques parallèles en Turquie. La plupart de la production d’études récentes, y compris ma thèse, ne se fonde que sur un corpus d’études produit principalement dans des universités établies des métropoles turques et leurs cercles étendus de contacts à l’étranger. Or le travail de cet establishment académique basé à Istanbul et en partie à Ankara, qui ne prend généralement pas en compte les matériaux produits ailleurs, n’annule pas l’existence d’une industrie éditoriale négationniste florissante en Turquie avec laquelle les intellectuels stambouliotes n’ont pas de contact et sur laquelle ils n’ont pas la moindre influence. Quand des universitaires ou des journalistes écrivent sur la scène éditoriale et académique de Turquie, ils font semblant de croire que cet univers parallèle n’existe pas et donnent l’impression que toute la production académique progresse positivement. Mais quelles que soient nos réserves sur la validité de ces travaux par rapport à nos critères de rigueur académique, le fait est qu’ils ont une large présence à travers le pays, relayés par toutes sortes de centres de recherches, revues universitaires, magazines et maisons d’édition. De ce point de vue, les conditions matérielles de soutien que l’État turc accorde à ces universités et universitaires – pour la plupart d’État – n’ont pas changé, car la politique d’État est toujours celle d’une négation active du génocide à la fois dans le pays et à l’étranger, même si les instruments rhétoriques ont pu évoluer depuis 2014.
Par ailleurs, la constellation d’ouvrages universitaires et populaires produits au cours des quinze dernières années sur l’histoire récente de la Turquie reflète clairement les ravages que le déni, la trivialisation et l’obscurantisme ont causés aux manuels d’enseignement supérieur d’« Histoire et politique du Moyen Orient ». C’est dans ce domaine qu’on observe les effets collatéraux les plus larges de cent ans de silence, de minoration et de rejet en bas de page pratiqués par les historiens ottomanistes. Parmi les cinq premiers manuels utilisés à l’université, aucun de mentionne le Génocide arménien sans exprimer de réserves. William Cleveland présente un contexte et quelques détails mais survole le débat sur le génocide ; Mehran Karmravacite brièvement un nombre de 1,5 millions de victimes mais emploie « Génocide arménien » entre guillemets dans une note de fin de volume tout en contestant le décompte de Lord Kinross et lui opposant les chiffres avancés par Bernard Lewis. Ces textes, largement prescrits à l’université, sont saturés de récits symétriques où les revendications pour la reconnaissance du génocide sont mises en balance avec des affirmations négationnistes sous forme de « les Arméniens affirment que, les Turcs affirment que », sans mise en contexte correcte.
Il ne faudrait pas imaginer cependant – et cet article ne veut certainement pas le donner à penser – qu’un débat sur la terminologie soit suffisant pour combler ce qui manque profondément à ce domaine d’études. Il y a des « tabous dans le tabou » qui auraient pu être étudiés. Les universitaires auraient pu guider les recherches de leurs propres étudiants ou structurer leurs programmes autour de ces sujets sans employer le terme de génocide. Un de ces sujets est le sort des propriétés arméniennes et d’autres chrétiens. Jusqu’à récemment, ce sujet est resté un des moins étudiés. Il est vrai que les archives du cadastre ottoman sont fermées malgré le fait qu’il a été numérisé en 2005. Mais le manque de recherches sur l’aspect économique de la destruction ne peut pas être attribué uniquement à cette fermeture puisque les historiens connaissent un certain nombre de façon de reconstituer les preuves de propriété au niveau local.
Un autre problème majeur des études ottomanes a été l’exclusion des langues de l’empire du curriculum – les sources écrites en arménien, grec ou Ladino/hébreu ne faisant pas partie institutionnellement de l’histoire impériale ou de la Turquie. De plus, lors des rares occasions où les historiens ont fait des récits de massacres d’Arméniens, ils se sont fondés exclusivement sur des sources écrites par des non-Arméniens. Par exemple, la référence anecdotique de Carter Findley à l’ouvrage de l’historien américain Ronald Suny, Looking Toward Ararat [Indiana University Press, 1993] ne compense pas sa négligence des sources en langue arménienne ou même autres langues européennes ouvrant vers une interprétation bien différente des sources turques qu’il privilégie. Vryonis explique en détail les motivations politiques derrière l’exclusion des langues grecque et arménienne du champ des études moyen-orientales, non inclues au Programme officiel d’enseignement supérieur en langues étrangères américain (Title VI). Toutefois, une analyse approfondie de la façon dont ce facteur a façonné (ou déformé) les champs d’études turques, arméniennes et grecques contemporaines, etc. est encore à faire.
Il y a aussi des problèmes généraux de pertinence auxquels font face les sciences sociales et les humanités aujourd’hui, par exemple l’érosion du modèle de l’intellectuel classique et son remplacement par des auteurs populaires et des chroniqueurs de presse. Les universitaires, eux, sont contraints par une limite d’expression structurelle, à moins qu’ils ne contribuent à des organes d’expression grand public avec quelque régularité : Taner Akçam, par exemple, est un contributeur de presse régulier sur nombre de numéros dans le champ historique et au-delà. Bien qu’il soit difficile d’en évaluer la portée, on peut affirmer que, malheureusement, leurs écrits de vulgarisation sont plus lus au quotidien que leurs travaux académiques. En un sens, cela rappelle les programmes radiophoniques d’Adorno sur le rapport au passé et ses articles pour le Frankfurter Allgemeine et l’hebdomadaire Die Zeit, pointant vers d’autres lieux et pédagogies possibles pour remédier au problème. Bien que critique du média radiophonique, qu’il qualifiait de « bras de l’industrie culturelle réifiée », Adorno produisit à son retour en Allemagne de l’Ouest plus de cent émissions radio qui enrichirent la sphère sociopolitique allemande, près d’un tiers d’entre elles traitant de la question : « Que signifie assumer le passé ? » Dans ces émissions, Adorno tentait non seulement d’inculquer au public un intérêt pour ce que signifiait le passé mais aussi de les toucher par une pédagogie leur faisant sentir la nécessité d’une pensée introspective et d’une autonomie politique. Ceci nous amène à cette autre question complexe de la pédagogie et du rôle des universitaires dans ce domaine. « Assumer le passé »demande un travail non seulement sur les nombreuses facettes de l’histoire des génocides à la fin de l’ère ottomane mais aussi un travail philosophique comparatif sur la responsabilité. Parce que ce face à face avec l’histoire doit avoir lieu dans un contexte majoritairement musulman sunnite, les universitaires devront aussi réfléchir à la façon de convoquer des concepts formulés essentiellement à partir d’une tradition politico-philosophique occidentale – comprenant Karl Jaspers, Hannah Arendt, Walter Dirks, etc. –pour les appliquer pédagogiquement dans ce nouveau contexte. Voilà un autre domaine de recherche négligé ou réduit à des histoires particulières d’universitaires racontant fièrement comment ils ont réussi à accepter l’usage du mot en « G ». Ce qui manque à présent est un débat de fond sur les sujets suivants : la responsabilité ici et maintenant des universitaires socialement engagés ou non ; la relation entre justice et démocratie ; le racisme de l’élite ; la grammaire des relations interethniques.